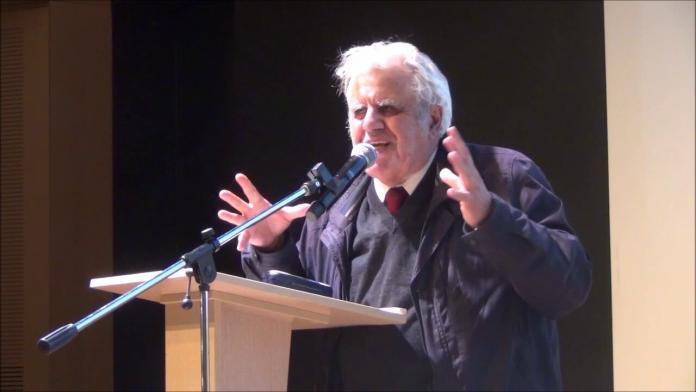Le passé et l’avenir de la Russie dans sa relation avec l’Occident
Le mirage occidental en Russie, hier et aujourd’hui.
Gérard CONIO : Professeur émérite de l’Université de Nancy
Comment concilier dans la Russie actuelle le double héritage du tsarisme et de l’Union soviétique avec la pratique de la démocratie ?
Cette question semble renvoyer à une quadrature du cercle, mais elle correspond cependant aux trois axes d’une politique centrée à la fois sur les valeurs patriotiques et sur l’économie libérale sans que cette conjonction semble nuire à la popularité d’un président qui défend habilement les intérêts nationaux de son pays, tout en continuant à protéger les privilèges d’une élite qui continue à s’enrichir au détriment du peuple.
On pouvait lire dans le dernier numéro du Monde diplomatique, un article bien documenté sur « Le visage antisocial de Vladimir Poutine » à propos de la réforme de l’âge de la retraite et de la dégradation du niveau de vie.
Cette question renvoie aux tensions actuelles entre la Russie et l’Occident qui font regretter les apaisements de la guerre froide, quand Nixon et Brejnev signaient des accords sur le désarmement.
Pour essayer d’y répondre il faut remonter aux causes de l’effondrement du régime soviétique qui a été suivi par les sinistres années quatre-vingt-dix où la Russie a bien failli disparaître en tant qu’Etat indépendant.
Contrairement aux vantardises des dirigeants américains qui se targuent d’avoir gagné la guerre froide, l’Union soviétique n’a pas été vaincue et elle avait encore toutes les chances de durer si elle ne s’était pas dissoute d’elle-même dans un processus d’autodestruction provoqué par ses dirigeants et par une élite acquise aux valeurs occidentales.
Il convient de rappeler que dans leur grande majorité les populations de l’Union soviétique avaient refusé sa disparition dans un référendum dont on n’avait pas tenu compte.
Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur la fin du communisme, il faut bien admettre que cette chute de l’Empire soviétique a été le fruit des rivalités personnelles au mépris de la volonté du peuple.
Pour comprendre le traumatisme subi par la population dans cette période d’anarchie où les mafias avaient pris le contrôle de la société et s’étaient substituées à l’Etat, il faut lire La Russie sous l’avalanche, le livre que Soljénitsyne a publié en 1998, l’année où la Russie s’est mise en faillite, achevant ainsi de ruiner la grande majorité de ses habitants.
Soljénitsyne rend compte du désespoir de ces gens livrés à la misère, au cynisme des prédateurs et à la criminalité des « voleurs dans la loi ». Quelques-uns, pourtant, osaient espérer la venue d’un homme providentiel qui rendrait à leur pays sa puissance et sa dignité.
Il faudrait beaucoup de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que Vladimir Poutine a rempli cette tâche et continue d’incarner la fidélité à une identité nationale que les fossoyeurs de l’Union soviétique avaient reniée en prenant modèle sur les démocraties occidentales.
C’est pourquoi dans les débats qui ont cours sur la politique de Vladimir Poutine, il est facile de distinguer ceux qui aiment sincèrement la Russie et ceux qui considèrent qu’elle constitue un danger pour l’humanité.
On aurait tort pourtant d’attribuer cette politique au nationalisme de Vladimir Poutine, à sa haine de l’Occident et au retour d’un impérialisme sans foi ni loi.
Il n’a pas attendu Macron pour faire la distinction entre le patriotisme et le nationalisme.
Et, comme a pu l’affirmer Helena Perrout dans son livre sur Un Russe nommé Poutine, il a toujours tendu la main à ses partenaires occidentaux pour établir des échanges équitables dans le respect d’une souveraineté compatible avec la multipolarité mais non avec le multiculturalisme.
La crise des relations entre la Russie et l’Occident a, en fait, été provoquée par une double désillusion.
Devant le redressement de la Russie grâce au renforcement de l’autorité de l’Etat, l’opinion occidentale a estimé dans son ensemble que le pays des Tsars était définitivement inapte à la démocratie.
Et le peuple russe a désormais confondu la démocratie avec la prédation du bien commun par des groupes de pression qui utilisaient des moyens criminels pour s’enrichir.
En faisant le procès d’un régime que l’on identifiait au Goulag et à la Grande Terreur, on a favorisé les intérêts privés et un individualisme effréné qui ont entraîné la décomposition du tissu social.
Pour mieux comprendre l’enchaînement de ces malentendus il faut opérer dans l’histoire soviétique une distinction fondamentale entre le Parti et l’Etat, entre les motivations de l’idéologie et une cause commune extérieure à ces inspirations partisanes.
On peut créditer Mikhaïl Gorbatchev d’avoir mis fin au communisme, mais il a aussi trahi son pays et son peuple en le livrant sans contrepartie aux puissances adverses pour mieux prouver sa bonne foi.
C’est cette douloureuse expérience, renforcée plus tard par l’adhésion de la Russie au démembrement de la Yougoslavie, qui inspire aujourd’hui la méfiance du peuple russe envers des valeurs occidentales qui ne sont jamais entérinées par les faits.
La politique de Vladimir Poutine est le reflet de ce recul de l’occidentalisme face à la slavophilie, dans l’éternel débat qui divise l’intelligentsia russe depuis le XIX ème siècle.
Il en résulte une ambiguïté fondamentale dans le rapport au passé tsariste et soviétique.
Vladimir Poutine a fustigé la « trahison » des Bolcheviks dans la première guerre mondiale.
Et les nostalgiques du communisme ont le droit de relever une contradiction entre l’exaltation de la victoire sur l’Allemagne hitlérienne et le rejet d’un héritage incompatible avec le Marché qui reste, comme en Occident, le principal ressort de l’économie russe.
Cette déconnexion s’explique sans doute par un pragmatisme qui a pris définitivement ses distances avec « l’utopie au pouvoir ».
Bien que formé au KGB et fidèle à son éducation soviétique, Vladimir Poutine n’en a pas moins été promu à ses fonctions par les maîtres d’œuvre des réformes libérales qui ont poussé la Russie dans le gouffre : Tchoubaïs et Koudrine.
La pratique d’un pouvoir qui s’appuie sur deux pieds, le patriotisme et le libéralisme, montre sans doute qu’on peut être libéral tout en restant patriote.
Si Berezovski, dans la part qu’il a prise à l’ascension de Vladimir Potuine, était inspiré par des calculs personnels, il est fort possible que Boris Eltsine lui-même, conscient de ses erreurs et de ses fautes, ait voulu ménager l’avenir en nommant un successeur capable de sauver la Russie du naufrage.
Ce mélange des genres est aujourd’hui revendiqué par nombre de dirigeants occidentaux, à commencer par le nouveau président des Etats-Unis.
Mais la compétition qui régit les relations internationales, en aiguisant les conflits, rend aujourd’hui plus imminente la perspective d’une apocalypse nucléaire que dans l’ancienne guerre froide qui opposait deux blocs dont les rapports de forces étaient relativement équilibrés.
Vladimir Poutine a pu dire quand on lui objecte qu’une guerre nucléaire risquerait d’entraîner la fin du monde : « Que m’importe le monde si la Russie n’y est plus ? » Et il a renchéri en ajoutant que s’il était obligé de provoquer la catastrophe en ripostant à une attaque : « Nous serions des martyrs et nous irions au ciel, tandis que les autres n’auraient qu’à crever. »
Ces mots rappellent ceux de Baudelaire : « La monde va finir, mais qu’est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ? »
Ces déclarations ne signifient pas pour autant un catastrophisme inéluctable, mais elles témoignent de la crise de confiance entre la Russie et l’Occident qui a mis fin temporairement, au moins au sommet de l’Etat, à ce que j’appellerai « le complexe d’Oblomov ».
Dans le roman de Gontcharov, Oblomov incarne la Russie patriarcale enfermée dans son apathie et dans ses rêves, face à Stolz, l’allemand dynamique et entreprenant.
Il semble que tout au long de son histoire la mentalité russe ait été hantée par la conscience de l’arriération d’une société rurale longtemps enlisée dans le servage et par la comparaison avec le progrès social, politique et technologique des pays occidentaux urbanisés et industrialisés.
Et à la suite de Pierre le Grand les esprits soucieux de réformes ont toujours pris modèle sur ce dynamisme des pays occidentaux.
Pour autant ni le peuple ni les élites n’ont jamais abdiqué en Russie leurs traditions, leur religion et leur différence avec les cultures occidentales.
Même l’Union soviétique, après la rupture de la révolution, a constamment renforcé cette continuité avec un passé national distinct de celui de l’Europe occidentale.
Vladimir Poutine se situe au confluent de ces aspirations à la fois conservatrices et progressistes.
Et s’il faut faire la part de l’idéologie dans l’antagonisme croissant entre la Russie et l’Occident, c’est aujourd’hui en Occident qu’elle joue un rôle particulièrement négatif, en cultivant une image caricaturale de la Russie taxée d’obscurantisme et de dérive autocratique.
Il suffit de vivre quelque peu en Russie pour démentir ces affabulations diffamatoires qui nourrissent les préjugés de l’opinion occidentale courante.
C’est donc le choc des cultures, fondé sur l’ignorance, qui explique aujourd’hui la nouvelle cassure entre la Russie et l’Occident.
Si l’Occident aspire au bonheur que l’on confond trop souvent avec le confort, avec un hédonisme vulgaire, la Russie a toujours été dominée par la recherche du salut.
Le mythe de Moscou Troisième Rome a pris ainsi des incarnations différentes en couvrant parfois un messianisme impérialiste mais en renvoyant aussi au désert qui favorise la vie intérieure et le retrait du monde.
Ces considérations renvoient à ma communication au colloque organisé le 6 novembre dernier par l’Académie géopolitique de Paris sur « Le nouvelle émergence de la Russie ».
Je m’y référais à la fois à mon dernier livre sur La Russie et son double et à une ancienne publication sur La vision russe de l’Occident où j’avais reproduit la première lettre philosophique de Tchaadaïev qui lui avait valu d’être assigné à résidence jusqu’à la fin de ses jours afin d’éviter que sa « maladie mentale » contamine ses compatriotes par son virus occidentaliste…
Voici comment, en 1829, Tchaadaïev retraçait l’histoire de son pays :
« Une brutale barbarie d’abord, ensuite une superstition grossière, puis une domination étrangère, féroce, avilissante, dont le pouvoir national a plus tard hérité l’esprit, voilà la triste histoire de notre jeunesse. Cet âge d’activité exubérante, du jeu exalté des forces morales des peuples, rien de semblable chez nous. L’époque de notre vie sociale qui répond à ce moment a été remplie par une existence terne et sombre, sans vigueur, sans énergie, que rien n’animait que le forfait, que rien d’adoucissait que la servitude. Point de souvenirs charmants, point d’images gracieuses dans la mémoire, point de puissantes instructions dans la tradition nationale. Parcourez de l’œil tous les siècles que nous avons traversés, tout le sol que nous couvrons, vous ne trouverez pas un souvenir attachant, pas un moment vénérable, qui vous parle des temps passés avec puissance, qui vous les retrace d’une manière vivante et pittoresque. Nous ne vivons que dans le présent le plus étroit ; sans passé et sans avenir, au milieu d’un calme plat. Et si nous nous agitons parfois, ce n’est ni dans l’espérance ni dans le désir de quelque bien commun, mais dans la frivolité puérile de l’enfant qui se dresse et tend les mains au hochet que lui montre sa nourrice. »[1]
Au même moment, dans son livre sur La Russie en 1829, le marquis de Custine qui avait cru trouver en Russie la réalisation de ses idées monarchistes, exprimait sa déception dans des termes analogues.
Plus tard, en 1837, Tchaadaïev, dans « L’Apologie d’un fou », répondra au jugement qui l’avait mis au ban de la société ; tout en acceptant son sort, il justifiait sa position dans une déclaration qui devrait être écrite en lettres d’or au fronton des écoles :
« C’est une très belle chose que l’amour de la patrie ; mais il y a quelque chose de mieux que cela, c’est l’amour de la vérité. L’amour de la patrie fait les héros, l’amour de la vérité fait les sages, les bienfaiteurs de l’humanité ; c’est l’amour de la patrie que divise les peuples, qui nourrit les haines nationales, qui parfois couvre la terre de deuil ; c’est l’amour de la vérité qui répand les lumières, qui crée les jouissances de l’esprit, qui rapproche les hommes de la divinité. Ce n’est point pas le chemin de la patrie, c’est par celui de la vérité que l’on monte au ciel. » [2]
Tchaadaïev était devenu de son plein gré un émigré de l’intérieur et Mandelstam a magnifiquement exposé le dilemme auquel Tchaadaïev avait été confronté lorsque, après avoir été ébloui par la découverte de l’Europe, il avait décidé malgré tout de retourner dans sa patrie.
« Les contemporains, écrit Mandelstam, étaient stupéfaits de la fierté de Tchaadaïev et lui-même il croyait en son élection. Il se sentait élu et le dépositaire de son peuple mais ce peuple n’était déjà plus en disposition de le juger.
Quel étonnant démenti du nationalisme, cette pauvreté de l’esprit, qui en ap-
-pelle sans cesse à la monstrueuse justice de la populace !
En Russie, Tchaadaïev n’a trouvé qu’un seul don : la liberté morale, la liberté
de choix. Jamais en Occident elle n’a atteint une telle grandeur, une telle pureté, une telle plénitude. Tchaadaïev s’en est emparé comme d’un bâton de pèlerin et il est allé à Rome.
Je crois qu’un pays et un peuple se sont déjà justifiés s’ils ont créé ne serait-ce qu’un seul homme totalement libre, qui a désiré et a su se servir de cette liberté.
Quand Boris Godounov, devançant l’idée de Pierre, a envoyé à l’étranger de jeunes russes, aucun d’eux n’est revenu. Ils ne sont pas revenus pour cette simple raison qu’il n’existe pas de chemin de retour de l’être au néant, qu’ils seraient morts étouffés dans la suffocante Moscou après avoir goûté au printemps éternel de l’immortelle Rome.
Les premières colombes ne sont pas retournées non plus dans l’arche.
Tchaadaïev a été le premier russe, en effet, à résider en Occident par fidélité à ses idées et à trouver le chemin du retour. Les contemporains l’ont senti instinctivement et ils ont terriblement apprécié la présence parmi eux de Tchaadaïev.
Ils pouvaient le désigner avec un respect superstitieux, comme jadis on montrait Dante : « Celui-là a été là-bas, il a vu et il est revenu. »
Et combien d’entre nous dont l’âme a émigré en Occident ! Combien parmi nous vivent dans un tel dédoublement inconscient, dont le corps est ici et l’âme est restée là-bas !
En nous gratifiant de la liberté intérieure, la Russie nous met devant un choix, et ceux qui ont fait ce choix, où qu’ils s’intègrent, sont les véritables hommes russes. Mais malheur à celui qui, ayant tourné autour du nid natal, par veulerie prend le chemin du retour ! » [3]
Ce choix déchirant a taraudé tout au long de l’histoire russe ces émigrés de l’intérieur qu’à une certaine époque on a appelé « les dissidents », atteints par une endémie qu’on pourrait désigner comme « le mirage de l’Occident »
Ce « mirage » a été parfois conforté par la découverte d’une civilisation dont l’apparence brillante, la liberté, rendait encore plus « suffocantes » des « conditions de vie » qui paraissaient archaïques et indignes. L’existence du servage a longtemps été une tare humiliante pour les Russes de la haute société qui parlaient français et se targuaient de leur éducation, de leur culture.
Le mouvement décembriste est né parmi les officiers de la noblesse qui avaient occupé la France après la chute de Napoléon. De retour dans leur patrie ils avaient conspiré pour renverser un régime dont la tyrannie leur paraissait désormais obsolète.
On a pu remarquer que les plus grands écrivains russes, Dostoïevski, Gogol, Tourgueniev, ont aimé voyager en Occident et y ont souvent écrit leurs œuvres.
Il faudrait examiner de plus près ce que signifie pour les Russes ce qu’ils appellent l’Occident qui déborde toujours les frontières géographiques pour constituer une entité aux contours indéfinis qui prend seulement sa consistance quand on l’oppose à la Russie.
L’Occident ne saurait en effet se réduire à la France ou l’Allemagne ou l’Italie ou l’Espagne ou l’Angleterre et il ne faut pas le confondre avec l’Europe.
L’Occident a pu récemment prendre le visage des Etats-Unis sans pour autant y être circonscrit.
Cet Occident mythique, métaphysique, a toujours exercé sur les Russes un mélange d’attraction et de répulsion car il a toujours été l’objet d’un mélange contradictoire de sentiments d’infériorité et de supériorité.
Quand Alexandre Blok revient d’Italie, il appréhende de retrouver dans son pays « le monde terrible ». Après avoir accepté la révolution d’octobre il a demandé l’autorisation d’aller se soigner à l’étranger, mais il mourra en 1921 sans l’avoir obtenue.
On ne compte pas les vies hantées par le désir impuissant de fuir le « monde terrible ».
Mikhaïl Boulgakov a toute sa vie rêvé de l’Italie, le pays magique où on mange des pâtes et où joue de la mandoline. Mais son protecteur Staline ne le lâchera jamais.
Le poète et diplomate Tiouttchev était persuadé qu’un abîme irréductible séparait la Russie et l’Occident. Il a inscrit dans des vers célèbres le mystère de l’âme russe qui restera à jamais fermée pour un esprit occidental : « On ne peut pas comprendre la Russie par la raison, on ne peut pas la mesurer. Elle a un caractère particulier. On ne peut que croire en elle. » Il a pourtant résidé la plus grande partie de sa vie dans cet Occident qu’il déteste et considère comme l’ennemi de la Russie. Mais quand il doit rentrer définitivement dans sa patrie bien-aimée, il est désespéré et aspire à continuer à goûter au « printemps éternel de l’immortelle Rome »…
Il y a les patriotes qui préfèrent la douceur occidentale à la boue russe, mais il y a les révolutionnaires qui attendent le salut de l’Occident démocratique et qui perdent leurs illusions quand il est trop tard.
Après avoir émigré au paradis de la liberté Herzen comprendra qu’il y avait plus de chances de changer le monde en Russie qu’en Occident où les dés sont pipés.
L’Occident restera toujours pour les Russes une utopie inaccessible, un mirage nourri des siècles de refoulement et d’attente d’un avenir meilleur
Mais sauf les opportunistes toujours prêts à se vendre pour un plat de lentilles, ceux qui s’exilent par amour de la liberté et des droits de l’homme ne tardent pas à découvrir des réalités incompatibles avec des valeurs affirmées dans les discours mais contredites par les actes.
Après son expulsion, Soljénitsyne est accueilli à l’Occident comme un héros mais il ne se reconnaît pas dans le matérialisme d’une société sans âme.
Alexandre Zinoviev a projeté lui aussi sur l’Occident son rêve d’une vie sans entraves, mais la guerre de Yougoslavie lui ouvre les yeux sur un système de domination qui ne connaît que les rapports de forces.
Et il retrouve sous des formes plus sournoises les mêmes « hauteurs béantes » qu’il a dénoncées dans son pays sous le communisme.
Le sens de l’histoire a simplement changé de registre, mais il s’appuie sur la même absence d’alternative, le même langage totalitaire.
« Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous », la règle de fer des Bolcheviks n’est-elle pas appliquée dans les démocraties à l’égard de ceux qui osent pratiquer la liberté de parole.
Ceux qui refusent de se soumettre à ce diktat sont soumis à une censure qui ne dit pas son nom. Frédéric Taddeï, un journaliste qui osait inviter à ses émissions des « persona non grata » a été progressivement poussé vers la sortie. Il a trouvé un refuge à « Russia To Day », la télévision russe honnie par nos médias et interdite d’accréditation par l’Elysée pour avoir reproduit des informations de la presse française jugées des « fakes » par le chef de l’Etat.
Après avoir adressé une « lettre à Macron » où il exprimait des critiques qui relevaient de son droit de citoyen, Michel Onfray est victime du même ostracisme et chassé de France-Culture qui diffusait depuis des années ses cours de contre-histoire de la philosophie ».
Si le lanceur d’alerte Edward Snowden n’avait pas obtenu un refuge en Russie il aurait connu un mauvais sort. Et on a vu le président de la patrie des droits de l’homme arrêter l’avion du président bolivien suspecté de transporter l’ennemi public dc ce qu’on appelait jadis « le monde libre ».
Cette chasse à l’homme ne gêne en rien les apologistes d’une démocratie qui est de plus en plus démocratique dans les mots et de plus en plus totalitaire dans les faits.
Nous vivons une guerre des représentations où chacun substitue à la réalité vécue les impulsions de son « tiers inclus ».
Certes, personne n’échappe à cette loi qui gouverne les sociétés en propageant des vérités infuses fabriquées de toutes pièces pour se conformer à l’idéologie dominante.
La discussion est devenue impossible sur des sujets tabous qui sont boycottés par l’information même quand les dirigeants occidentaux, obligés de jeter du lest, se compromettent avec l’ogre russe.
Récemment Merckel, Macron, Erdogan et Poutine se sont réunis à Istamboul pour régler la question syrienne, mais ce sommet n’a pas été couvert par les « médias » occidentaux.
Depuis sa montée en puissance et la fin de sa lune de miel avec l’Occident, la Russie est au ban de ce qu’on appelle « la communauté internationale ». Mais les bons esprits estiment que la russophobie est une invention de la propagande russe.
La politique occidentale aura toujours raison même quand elle a tort, même quand elle commet des crimes contre l’humanité, parce que, comme hier l’Union soviétique pour les communistes, elle est toujours lavée par ses bonnes intentions.
Il y a les bons et lés méchants, les purs et les impurs.
Il y a aussi le vrai et le faux dans une perpétuelle inversion des rôles.
L’Otan encercle la Russie d’un étau de plus en plus menaçant mais c’est la Russie qui est accusée d’être trop proche des bases de l’Otan.
On vient de fêter en grande pompe la paix universelle qui règne, paraît-il, depuis soixante-dix ans grâce à l’Union européenne.
Mais il faut avoir une très courte vue de l’histoire pour ne pas remarquer que la paix règne en Europe parce que, grâce à l’Union européenne, l’Allemagne a gagné par sa puissance économique ce qu’elle n’avait pas pu obtenir par la guerre. Et on a oublié que sans le sacrifice de 27 millions de Russes, Hitler règnerait encore sur l’Europe.
Le conflit yougoslave a scellé l’alliance entre les Atlantistes et les Islamistes et la plupart des Russes ne doutent pas que si leur pays ne détenait pas la force nucléaire, il y aurait beau temps qu’il aurait connu le sort de la pauvre Serbie.
Il existe heureusement des voix divergentes que l’on tolère parce qu’il faut bien trouver un alibi à la fausse démocratie.
Quand on lit « L’Occident terroriste » de Noam Chomsky, on comprend mieux la vraie nature de cet Occident qui, comme l’Allemagne d’Hitler, se prétend « uber alles ».
Dans la guerre de Syrie le seul coupable désigné à la vindicte populaire et au châtiment suprême, comme le fut Khadafi, est le président Bachar El Assad, « bourreau de son peuple ». Et quand on objecte qu’en termes de droit il est toujours le président de son pays qu’il représente à l’Onu on répond qu’il n’est pas « légitime », parce que dans leur grande sagesse, les dirigeants occidentaux, seuls habilités à juger du bien et du mal, estiment qu’il doit en être ainsi.
Cette diabolisation des ennemis publics désignés a priori, souvent pour d’obscures raisons économiques et géopolitiques, procède d’une moralisation de la vie politique dont les résultats se sont révélés désastreux.
L’Occident a éliminé successivement sans pitié des marionnettes qui, après l’avoir servi, sont devenues gênantes et nuisibles : Saddam Hussein, Khadafi.
C’est la loi de la mafia qui est le paradigme le plus apte à décrypter les mécanismes des organisations qui gouvernent le monde, qu’il s’agisse du FMI ou de l’Union européenne, sans parler des Etats soumis au pouvoir des banques et devenus les instruments de l’oligarchie financière mondiale.
Pour creuser les vraies raisons des tensions actuelles qui font regretter le temps bienheureux de la guerre froide, il faut s’interroger sur la véritable signification des mots qui sont plus que jamais les instruments de la domination.
La corruption du langage est le cancer de la pensée selon la formule qui a fait ses preuves : « Maître des mots, maître des âmes ».
La nation, la patrie, le peuple, sont devenus des mots péjoratifs. Le souverainisme est une tare qui couvre la déchéance des Etats et le populisme est pétri de connotations abjectes qui confondent le peuple et la populace.
On brandit la menace russe pour justifier les sanctions destinées à détruire l’ennemi public numéro 1, en espérant que les populations appauvries se dresseront contre le seul chef d’Etat qui ose défendre la souveraineté de sa nation contre un nivelage qui cumule l’esclavage social, la dépendance économique et la dépravation morale.
Le complotisme est un argument commode pour réfuter des vérités masquées sous des interprétations fallacieuses.
Odessa, la ville la plus libre, la plus joyeuse du monde, a été le lieu d’un pogrom au cours duquel on a brûlé vifs dans la maison des syndicats les partisans de l’union avec la Russie.
On a fait porter aux victimes la responsabilité de cet « incendie » et les survivants sont encore en prison tandis que les auteurs de ces crimes commandités par le gouvernement de Kiev, parAvakov et Paroubyi, paradent comme des héros.
Mais dans notre libre France on fait passer pour des « fakes » les faits les mieux documentés, tandis que « les fakes » constituent la parole officielle à laquelle nul ne doit déroger.
Pour avoir une vraie compréhension des relations internationales il faudrait replacer dans leur contexte les guerres « humanitaires » qui, après la Yougoslavie, ont dévasté l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, engendré le terrorisme islamiste et provoqué la crise des migrants qui est en voie de détruire l’Europe au nom des droits de l’homme.
Ces faits sont des lieux communs connus de tous, mais ils sont remplacés dans l’opinion publique par une vision fantasmagorique de l’histoire qui invariablement fait de la Russie lr coupable idéal, l’ennemi absolu, jugé d’avance non par ses fautes jamais prouvées, mais par son existence même, par sa volonté d’affirmer une « identité » ressentie comme un blasphème par les Croyants du Nouvel Ordre Mondial qui s’est installé sur les décombres de ce qu’on appelait sous le communisme « la Nouvelle Foi ».
On assiste à un retournement psychologique qui refait l’histoire selon les injonctions du moment.
On pourrait s’étonner au nom des « valeurs européennes » que Bandera soit devenu officiellement le héros national de l’Ukraine, bien qu’il ait massacré pendant la guerre des centaines de milliers de Polonais et de Juifs. Mais il est lavé de tout soupçon pour avoir combattu l’armée rouge.
Le président de Svoboda, Oleg Tyagnygbok a été l’un des principaux interlocuteurs des Européens et des Américains qui ont soutenu Maïdan.
Il a été l’un des signataires des accords entre l’opposition et le président Yanoukovitch sous l’égide des ministres des affaires étrangères de France, de Pologne et d’Allemagne.
Les néo-nazis qui ont été le fer de lance de « la révolution dans la dignité » ont profité du désarmement des Berkoutes prévu dans les accords pour les massacrer et prendre le pouvoir par la force.
Les trois ministres européens ont laissé faire les événements et n’ont pas jugé bon d’honorer leur signature.
On doit donner une mention spéciale à Laurent Fabius qui a serré la main à Tyagnybok et l’a adoubé comme un héros de la liberté.
Le même Fabius avait félicité le Front Al Nosra, une organisation terroriste issue d’Al Kaïda, parce que dans le conflit syrien celle-ci « faisait du bon boulot ».
Svoboda se réclame ouvertement d’Hitler, arbore le drapeau et les insignes nazis et a repris le programme d’épuration ethnique mis en œuvre par Bandera et Chioukevitch sous l’occupation hitlérienne.
L’intellectuel du parti, Youri Mikhalchyshyn, député au Parlement, a déclaré que l’holocauste avait été « une période de lumière dans l’histoire ».
André Parouby, commandans de MaÎdan et responsable du Conseil de sécurité André Paroubyi, responsable du Conseil de sécurité, a été le commandant de Maîdan et a revendiqué l’emploi de la violence pour prendre le pouvoir. Il est soupçonné d’avoir ordonné à des snipers géorgiens qui ont reconnu les faits les meurtres de « la centurie céleste » officiellement attribués aux Berkoutes.
En Europe on cajole ce beau monde qui fait toujours figure de victime de l’agression russe, après la soi-disant annexion de la Crimée et la sécession du Donbass.
Et vous ne trouverez jamais ces personnages sur France-Info ou BFM, ni dans la presse bien-pensante. Les sujets qui font mauvais genre sont tabous dans nos «médias » aussi bien que dans les discours officiels.
Il y a une bienséance de la bien-pensance qui est une arme bien rodée pour empêcher les mauvaises idées de circuler du bouche à oreille. C’est seulement sur Internet qu’on trouve des sites qui osent montrer l’envers du décor.
La libération de l’Europe par l’armée rouge est aujourd’hui considérée comme une occupation et il est clair que l’ancienne alliance entre les démocraties occidentales et l’Union soviétique contre Hitler mérite une révision complète.
On élève dans les pays baltes des monuments aux Waffen SS et on y met en prison les résistants au nazisme accusés de trahison.
Pourtant, parmi les libéraux qui vilipendent le régime « autocratique » de Vladimie Poutine, il y a des amis sincères de la Russie, mais ils sont victimes de leur « tiers inclus » qui substitue à l’expérience et à l’observation des projections déconnectées des réalités et nourries par la manipulation de l’opinion.
On rappelle souvent le mot d’Alexandre III qui disait que les seuls amis de la Russie étaient son armée et sa flotte. Et il est vrai que la Russie est aujourd’hui asez forte et assez unie autour de son chef pour ne pas redouter une agression extérieure. Mais les années quatre-vingt-dix ont montré que si la Russie, au cours de son histoire, avait pu vaincre les Mongols, les Chevaliers Teutoniques, la Grande Armée de Napoléon et l’invasion hitlérienne, elle restait vulnérable à l’intérieur si elle cédait aux sirènes du « mirage occidental ».
Pour comprendre les événements qui ont précipité la chute de l’Union soviétique et plongé le peuple dans un chaos sanglant, il importe de faire remonter à la surface un syndrome de l’Occident qui n’a cessé de miner la mentalité russe jusqu’à l’avènement de Gorbatchev.
Mikhaïl Gorbatchev est autant célébré en Occident qu’il est honni en Russie, pour avoir été l’artisan d’un effondrement qui aurait pu être la solution finale de l’histoire russe.
Quant à Eltsine, Anne Nivat a justement rappelé le traumatisme des années 90 pour expliquer le résultat des dernières élections présidentielles.
On ne saurait pour autant expliquer par la seule action des personnes le cours de l’histoire, et même les réformes de Pierre le Grand n’ont été que le symptôme et non la cause d’un rapport à l’Occident qui provient de la condition même d’un pays à la recherche de son identité et de son unité.
Tchaadaïev a pointé dans « L’Apologie d’un fou » cette déchirure originelle entre l’Orient et l’Occident, entre l’Eurasie et l’Europe, qui pousse la Russie, comme la troïka de Gogol, vers un ailleurs indéterminé :
« Il est un fait qui domine souverainement notre marche à travers les siècles, qui parcourt notre histoire toute entière, qui comprend en quelque sorte sa philosophie, qui se produit à toutes les époques de notre vie sociale et détermine leur caractère, qui est à la fois l’élément essentiel de notre grandeur politique et la véritable cause de notre impuissance intellectuelle, ce fait, c’est la fait géographique. » [4]
La Russie absente et présente, tel est le titre d’un essai publié en 1949 par Vladimir Weidlé sur la vocation européenne de la Russie.
Mais cette vocation a toujours été contrebalancée par la tentation asiatique, par le poids exercé sur les mentalités par la domination mongole mis en exergue par les Eurasiens, hier Lev Goumilev ou Piotr Souvtchinski et aujourd’hui Alexandre Douguine.
Cet aspect est d’ailleurs invoqué aujourd’hui par les détracteurs de la Russie qui assimilent son héritage à une barbarie incompatible avec la civilisation européenne.
Et il faut distinguer constamment l’intelligentsia et le peuple qui ont suivi dans l’histoire russe des trajectoires parfois convergentes mais le plus souvent opposées.
C’est au bagne, dans « la maison des morts » que Dostoïevski a découvert dans le peuple une humanité que l’intelligentsia avait perdue en se tournant vers l’Occident.
Et l’avenir lui donnera raison puisque c’est à l’étranger, au contact des idées européenne, que Lénine et les autres penseurs révolutionnaires ont fait table rase du passé russe et posaient les fondements du nihilisme contemporain.
Quand le but justifie les moyens, quand l’image du Père est détrônée aussi bien dans la famille que dans la patrie, quand Dieu est mort, quand tout est permis, la place est ouverte pour le culte de l’Individu absolu.
On entre alors dans une société horizontale sur le modèle que l’Occident a donné à la Russie au nom du progrès, de l’égalité, de la fraternité dans la terreur, car quand il n’y a plus d’ordre, plus de rang, plus d’échelle de valeurs, il n’y a plus de droit et plus de loi.
Le monde humain retombe dans l’animalité, il retourne à la matière originelle, où il n’y a plus de différences, plus de qualités, et la sensation elle-même n’est plus que le simulacre du sens de la vie.
Après avoir subi l’épreuve du nihilisme occidental, comme une initiation à la fausse modernité et à la fausse démocratie, la Russie est retournée vers ses origines spirituelles, vers la recréation de l’espace et du temps par la ressuscitation, comme le souhaitait Fiodorov dans sa philosophie de l’œuvre commune, philosophie ni subjective, ni objective, mais projective.
Les obstacles, on le sait, exacerbent le désir de les franchir, d’aller ailleurs, vers la liberté. La Russie a été longtemps fermée au monde extérieur par le rideau de fer. Les interdictions sont des preuves d’obscurantisme, et elles ont été des alliés puissants du «mirage occidental ».
La Russie n’a jamais été un pays facile d’accès et elle reste un pays qui se mérite, qui se gagne. Et quand on demande avec dédain ce qu’elle peut apporter au monde, c’est-à-dire à l’Occident on peut répondre comme Mandelstam, que la Russie donne à ceux qui la méritent « la liberté intérieure ».
A travers les catastrophes, face à l’homme occidental qui est l’homme spéculatif, l’homme russe est l’homme créatif ; l’art, le théâtre, la musique, la danse, la littérature, le cinéma y sont toujours empreints d’un sentiment métaphysique porteur d’une vision globale du monde. Et leurs créations n’ont pas le sens frelaté donné par les modes, mais le sens spirituel et existentiel que l’on trouve chez les grands artistes russes, les Vroubel, les Kandinsky, les Malévitch, les Scriabine, les Meyerhold, les Eisenstein.
On a beau jeu d’isoler la Russie, de la mépriser, de la dénigrer, mais parce qu’elle veut assumer son double héritage tout en s’ouvrant sur la démocratie, elle reste un défi qui continuera longtemps à nous interroger sur nous-mêmes.
[1] Piotr Tchaadaïev, « Lettre première » » 1929 in : La vision russe de l’Occident ( dir. Gérard Conio), L’Age d’homme, Lausanne, octobre 1987. p. 75
[2] Piotr Tchaadaïev, « Apologie d’un fou (1837)», La vision russe de l’Occident, idem, p. 85.
[3] Ossip Mandelstam, « Piotr Tchaadaïev » (traduit du russe par Gérard Conio), La vision russe de l’Occident, op.cit. p. 72-73.
[4] Piotr Tchaadaïev, « Apologie d’un fou », op. cit. p ; 94-95