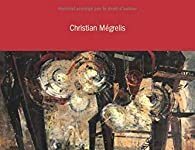Maître Maurice Buttin, président d’honneur du Comité de Vigilance pour une Paix réelle au Proche-Orient (CVPR PO)
Résumé
Nombreux sont ceux qui ont pointé du doigt tant le contenu du Plan du Siècle que le coup porté par celui-ci au droit international. Mais quelle fut la place de la question palestinienne dans le droit international, et inversement, quel cadre ce dernier a-t-il dressé dans le règlement du conflit israélo-palestinien avant et après la Guerre des Six Jours ? Depuis la proclamation de Balfour, en passant par la création de l’Etat d’Israël, le droit international, porté par les Nations Unies, a inscrit la naissance du sionisme, les évolutions successives du conflit et les espoirs d’une solution à deux Etats. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Summary
The Deal of the Century has been criticized several times for its content as well as for the shot it has triggered upon international law. But what role did the Palestinian issue play in redefining international law, and conversely, what frame has this legislation built in dealing with the conflict between Israel and Palestine before and after the Six-Day War ? From the Balfour declaration to the creation of Israel, the international law as it is drawn by the United Nations has weighed on the birth of sionism, on the successive evolutions of the conflict and has held the hopes of a two-State solution. Where does it lie today?
Chacun se souvient de l’affirmation prémonitoire du Premier ministre britannique, Winston Churchill, le 10 novembre 1942, au lendemain de la victoire d’El Almein : « Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais, c’est peut-être la fin du commencement ».
Je pense que nous pouvons, dès aujourd’hui, reprendre ces dires, quant à « la fin du commencement du sionisme », quant à la fin de ce que les médias désignent, à tort, comme le « conflit israélo-palestinien », alors qu’il s’agit simplement depuis 1967, de ce qu’un pays, Israël, occupe son voisin la Palestine.
Avant d’analyser les récentes décisions du président Donald Trump et son Plan historique de liquidation de la Palestine, ainsi que du droit international, il y a lieu de rappeler celui-ci, trop oublié, à l’heure actuelle, par de nombreux dirigeants occidentaux.
1°/ Le droit international et la question palestinienne avant 1967
Il y a lieu de noter que jusqu’à l’occupation totale de la Palestine, lors de la Guerre des six jours, en juin 1967, il n’a été question, à l’Assemblée Générale des Nations Unies et au Conseil de Sécurité, que de la « question palestinienne ».
Dès la proclamation Balfour le 2 novembre 1917 – reprenant les désirs de sionistes proclamés en août 1897 à Bâle (Suisse), lors de leur premier congrès mondial -, le sort de la Palestine est scellé. Au lendemain de la Grande Guerre et de la victoire des alliés, en effet, la France et la Grande-Bretagne ont convenu de mettre en œuvre les « accords Sykes-Pïcot », organisant à leur profit le partage de l’Empire ottoman au Proche-Orient. Le mandat sur la Palestine est confié par la Société des Nations, en 1922, aux Britanniques. Il reprend intégralement la promesse faite aux sionistes d’un « foyer national pour le peuple juif en Palestine ». (Décision non applicable à l’est du Jourdain, c’est-à-dire sur un territoire qui va constituer la Transjordanie, qui deviendra la Jordanie en 1949).
Les Palestiniens s’opposent, dès l’époque, à l’arrivée des juifs européens, de plus en plus nombreux depuis la montée du nazisme en Allemagne à partir de 1933. En 1936/37 éclate la grande révolte contre l’occupant britannique, voire contre les juifs. Ceux-ci répliquent par la constitution d’une armée secrète, la Haganah, qui deviendra l’armée israélienne après 1948. A relever que dès l’époque, après une féroce répression, les Britanniques, par le plan Peel, envisagent déjà le partage de la Palestine. Mais une nouvelle guerre s’annonçant, ils changent de politique, et par le Livre Blanc de 1939, ils envisagent un futur Etat unique, sous un gouvernement partagé.
Après la guerre de 1939/45, les juifs se soulèvent à leur tour contre ce plan, par une série d’attentats successifs très meurtriers pour les Britanniques. Ils les forcent ainsi à abandonner le devenir de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies, (ONU), la nouvelle organisation internationale, créée après la guerre, pour remplacer la Société des Nations (SDN) qui n’avait pu empêcher ce nouveau conflit monstrueux.
L’Assemblée Générale de l’ONU, par la Résolution 181, décide, le 29 novembre 1947, le partage de la Palestine en trois entités : un Etat juif – les juifs, qui représentent seulement le 1/3 de la population et occupent 7 % du territoire en obtiennent 54 % ; un Etat arabe – les Palestiniens 44 % ; Jérusalem et ses alentours – sont placés sous contrôle international en tant que corpus separatum.
Si les sionistes ont atteint leur premier but, il n’en est pas de même pour les Palestiniens, à qui aucun référendum d’autodétermination n’a été proposé, contrairement à l’article 1§2 de la Charte de l’ONU. Une lutte s’engage dans le pays, mais les forces armées israéliennes et milices juives sont bien supérieures. Elles écrasent la résistance palestinienne et près de 750 000 Palestiniens sont victimes d’un nettoyage ethnique ; plus de 500 de leurs villages sont détruits ! Expulsés, ces Palestiniens deviendront les « réfugiés », parqués dans les pays arabes voisins. C’est pour eux un désastre connu sous le nom de Nakba.
Le 14 mai 1948, le leader sioniste David Ben Gourion proclame l’Etat juif, pour le lendemain. Il se garde bien de lui donner des frontières. Il n’a pas oublié qu’en mai 1942, la Conférence sioniste, qui s’est tenue à l’hôtel Biltmore à New-York, sous son égide, a décidé d’établir un Etat juif sur la totalité du mandat britannique. La « Déclaration d’Indépendance » parle d’un « Etat juif et démocratique », et promet une pleine égalité entre tous les citoyens, sans considération de religion, d’appartenance ethnique ou de sexe. Mais cela, c’est pour rassurer l’Occident. Dans la réalité…
Les Etats arabes voisins, non organisés, non coordonnés, entrent alors en guerre contre Israël – dont l’armée est renforcée par de l’armement venu des pays de l’Est et d’URSS. Ils sont battus. Des armistices sont signés, en 1949, avec chacun de ces Etats et des lignes d’armistice provisoires sont établies. En ce qui concerne l’accord passé entre Israël et la Transjordanie, la ligne d’armistice devient la « ligne verte ». La Palestine est réduite à 22 % du mandat britannique ! La Transjordanie profite de la situation et, en accord de facto avec Israël, annexe la Cisjordanie, pour devenir la Jordanie.
Le 11 mai 1949, Israël est admis à l’ONU, mais à deux conditions : la reconnaissance de la Résolutions 181 (le partage) et de la Résolution 194 (le droit au retour des réfugiés chez eux et/ou à leur indemnisation). Assuré ainsi de son admission, Israël fera fi de ses engagements et n’exécutera pas plus ces Résolutions que les dizaines, pour ne pas dire les centaines, qui seront prises par l’Assemblée générale de l’ONU ou le Conseil de Sécurité à son encontre.
2°/ Le droit international et la question palestinienne après 1967
En juin 1967, Israël envahit la Palestine et l’occupe en totalité en six jours ! Le 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité, dans sa Résolution 242, « exprimant l’inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient ; soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre (…) exige « le retrait des forces armées des territoires occupés lors du conflit » ; et demande « le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de chaque Etat de la région, et de leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues ».
De son côté, le Général De Gaulle, dans une conférence prémonitoire déclare le 27 novembre : « On sait que la voix de la France n’a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s’est emparé en six jours de combat des objectifs qu’il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu’il a pris, l’occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsions, et il s’y manifeste contre lui une résistance qu’à son tour, il qualifie de terrorisme (…) Il ne peut y avoir de solution que par la voie internationale ».
Dès la fin de l’année 1967 le gouvernement israélien triple la surface de Jérusalem et annexe la partie arabe (Jérusalem-est). La ville trois fois Sainte est décrétée « capitale éternelle et indivisible d’Israël et du peuple juif ». La décision est condamnée par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 267 du 3 juillet 1967, qui stipule que « toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël (…) qui tentent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ».
La Résolution 465 du 1er mars 1980 déplore qu’Israël persiste et s’obstine dans ces politiques pratiques et demande à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance, qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés
A la suite la guerre de Ramadan ou de Kippour, en octobre 1973, le Conseil de Sécurité par sa Résolution 338 confirme la Résolution 242. La venue du président Sadat à Jérusalem, en novembre 1977, ne change rien pour les Palestiniens, sinon que le raïs déclare à la Knesset (le parlement israélien) : « Il n’y aura jamais la paix dans la région tant que le problème palestinien ne sera pas résolu ». Il ne s’est pas trompé !
Le 13 juin 1980, le Conseil européen, réuni à Venise, prend une claire position de principe, afin de jouer « un rôle particulier et d’œuvrer d’une manière plus concrète en faveur de la paix ». Il affirme « le moment venu de favoriser la reconnaissance et la mise en œuvre des deux principes admis par la Communauté internationale : le droit à l’existence et à la sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, et la justice pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance légitime des droits du peuple palestinien ».
Le Conseil précise : « Les Neuf soulignent qu’ils n’acceptent aucune initiative unilatérale qui ait pour but de changer le statut de Jérusalem » et « rappellent la nécessité pour Israël de mettre fin à l’occupation territoriale qu’il maintient depuis le conflit de 1967 (…) Ils considèrent que les colonies de peuplement, ainsi que les modifications démographiques et immobilières dans les territoires arabes occupés sont illégales au regard du droit international ».
Israël se moque éperdument de cette position prise par le Conseil européen, et, le 30 juillet 1980, la Knesset confirme dans une loi fondamentale : Jérusalem, comme « une et indivisible, capitale éternelle de l’Etat d’Israël ». Le Conseil de Sécurité, par sa Résolution 478, adoptée le 20 août, condamne dans les termes les plus énergiques l’adoption de cette loi, en « violation du droit international », et demande « à tous les Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la ville sainte ».
La décision de l’ONU est claire, Jérusalem « unifiée » ne peut-être la capitale d’Israël, en raison du plan de partage et par suite du changement illégal de la surface de la ville.
Aux lendemains de la première Intifada, en décembre 1987, la Jordanie renonce, en juillet 1988, à tous droits sur la Cisjordanie, et le 15 octobre 1988, le Conseil National Palestinien, réuni en Alger, sous la houlette de Yasser Arafat, proclame l’Etat de Palestine, sur la base des Résolutions 181 et 242 du Conseil de Sécurité. Les Palestiniens reconnaissent ainsi, de facto, Israël, mais ni cet Etat, ni les principaux Etats occidentaux, sous la pression des Israéliens, ne le reconnaissent.
Les Etats-Unis réussissent, en octobre 1990, à réunir à la Conférence de Madrid, Israéliens et Palestiniens (mais ceux-ci, dans la délégation jordanienne…).
Le 13 septembre 1993, en présence du Premier ministre israélien, Yithsak Rabin, du Président de l’OLP, Yasser Arafat et du Président étasunien, Bill Clinton, sont signés à Washington les « Accords d’Oslo », la « Déclaration de principe sur des arrangements d’autonomie » de la Palestine (…) « pour une période transitoire n’excédant pas cinq ans (…) menant à un arrangement permanent basé sur les Résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité de l’ONU ». Là où le bât blesse, c’est que ces accords renvoient à plus tard les trois questions essentielles : le statut de Jérusalem, celle des frontières et des réfugiés…
Après cette signature, une déclaration étonnante de Shimon Pérès, le ministre israélien des Affaires étrangères, est à relever : « Ce que nous faisons aujourd’hui est plus qu’une signature, c’est une révolution. Les peuples israéliens et palestiniens, qui ont combattu pendant près d’un siècle, se sont accordés à s’engager, de façon décisive, sur le chemin du dialogue, de la compréhension et de la coopération » ! Oubli de la réalité de l’idéologie sioniste, ou, plus simplement, affirmation hypocrite de Shimon Pérès pour tromper l’adversaire ?
Le 4 mai 1994, Y. Arafat et Y. Rabin se rencontrent au Caire, et signent un document concernant l’application de la Déclaration du 13 septembre. Il est décidé que la période d’autonomie palestinienne débutera à cette date et s’achèvera dans cinq ans. De nouveaux accords sont signés en 1995, Oslo II. L’assassinat du « traite » (selon B. Netanyahou) Y. Rabin, le 4 novembre 1995 et l’arrivée au pouvoir de celui-là en 1996, signent la fin de ces Accords. Netanyahou a tout fait pour les saboter.
Certes l’OLP et Yasser Arafat sont revenus en Palestine en 1994 et des élections ont lieu en Janvier 1996, mais la situation sur le terrain démonte le beau discours de Pérès : occupation, colonisation, répression, humiliation, arrestations, assassinats ciblés, démolition de maisons, mur de l’apartheid, (de 700 kms. de long, construit à plus de 85 %, sur des terres palestiniennes, dont le tracé délimite les enclaves palestiniennes) ; quartiers de Jérusalem annexés, totalement isolés de la Cisjordanie par les colonies et le murs ; Cisjordanie coupée en deux ; de 500 à 600 chekpoints, lieux d’humiliations quotidiennes ; etc. sont le sort quotidien des Palestiniens. La Bande de Gaza est devenue depuis juin 2007 une « prison à ciel ouvert », meurtrie par trois guerres successives. Elle est victime depuis le 30 mars 2018, de l’assassinat de plus de 300 manifestants non violents par des snipers jouant au tir aux pigeons, de milliers de blessés.
On assiste à une Politique d’apartheid de facto, aussi bien en Palestine occupée que dans l’Etat israélien lui-même ; de jure, aujourd’hui après la loi fondamentale du 19 juillet 2018 définissant Israël comme « Etat nation du peuple juif ».
Peu après la 2ème Intifada (début en septembre 2000), la Résolution 1397 du Conseil de Sécurité votée le 13 mars 2002 est considérée par certains comme « historique ». Rappelant les Résolutions 242 et 338, elle professe, pour la première fois « la vision d’une région où deux Etats, Israël et la Palestine vivraient, côte à côte, dans des frontières sûres et reconnues ». Le 27 mars 2002, la Ligue des Etats arabes approuve à l’unanimité une initiative saoudienne, qui propose en échange du retrait d’Israël des territoires occupés et d’une solution négociée de la question des réfugiés sur la base de Résolutions de l’ONU, la normalisation complète des relations des pays arabes avec l’Etat d’Israël. Cette proposition est rejetée par Israël.
Le 29 novembre 2012, la Palestine est au rang d’Etat observateur à l’ONU : 138 Etats ont voté « pour », les Etats-Unis, et 8 autres pays dont Israël, ont voté « contre ». Pour l’ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU, « cette résolution est malheureuse et contre-productive et met encore plus d’obstacles sur le chemin de la paix » (sic !)
3°/ Le droit international, la question palestinienne et Donald Trump.
Le 23 décembre 2016, la Résolution 2334 du Conseil de Sécurité, rappelant toutes les Résolutions précédentes précitées « exige de nouveau qu’Israël arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Elle est adoptée par 14 voix pour, aucune opposition, les Etats-Unis, alors présidés par le Président Obama, s’abstenant.
Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu 45èmPrésident des Etats-Unis. Son mandat débute le 20 janvier 2017. Le 6 décembre, il reconnait officiellement Jérusalem « capitale d’Israël », conformément à sa promesse électorale. Il juge que ses prédécesseurs ont manqué de courage, puisque le Congrès américain avait adopté cette disposition dès 1995 – les présidents successifs, républicains ou démocrates ayant maintenu leur ambassade à Tel-Aviv. Et Trump d’affirmer : « Nous avons enlevé Jérusalem de la table. Nous n’avons plus besoin d’en parler » ! Le 21 décembre l’Assemblée générale de l’ONU condamne à une très large majorité cette décision unilatérale. Fort de leurs dollars, les Etats-Unis menacent de représailles financières ceux qui ont voté contre leur décision.
Trump a annoncé, en même temps, son intention de déplacer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem., à la grande joie de ses électeurs les chrétiens évangéliques. Cela est fait officiellement le 14 mai 2018. Il y a lieu de noter que, ce jour-là, d’une part, deux pasteurs évangéliques étasuniens (très antisémites !) sont chargés de bénir cette nouvelle ambassade ; d’autre part, que des dizaines de Palestiniens de Gaza manifestant non violemment, dans le cadre de la « Grande Marche du Retour », sont assassinés ou blessés par les snipers israéliens ». Uri Avnery écrit sur le site de Gush Shalom le 26 mai 2018 : « Le monde entier a été témoin de cette association abominable, et, à peine quelques heures plus tard, à l’explosion de joie des masses sur la place centrale de Tel-Aviv pour la victoire de la chanteuse israélienne à l’Eurovision. Il a vu et n’a rien dit ».
Fort du soutien inconditionnel de Donald Trump, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, fait voter par la Knesset, le 19 juillet 2018, une loi fondamentale définissant Israël, comme « l’Etat-nation du peuple juif ». Face à ce qui est perçu comme une vraie menace démographique, Israël a tenu à consolider constitutionnellement les bases juives de l’Etat. Cette loi, en fait, est la confirmation d’une réalité existante depuis la création de l’Etat d’Israël. Elle s’inscrit dans l’idéologie sioniste, qui a toujours été ethnocentriste. Israël appartient à tous les juifs du monde, mais pas à ses citoyens arabes ! Cette loi élimine toute idée de démocratie – retenue (officiellement) par David Ben Gourion dans la « Déclaration d’Indépendance » d’Israël en 1948 – pour ceux qui ne sont pas juifs.
Selon Ahmed Tibi, député israélien la nouvelle loi fondamentale fonde « une théocratie qui a bâti un État comportant deux systèmes séparés : un pour la population privilégiée, les Juifs, et un pour les citoyens palestiniens arabes de seconde classe (…) Israël est officiellement devenu un régime d’apartheid fondé sur la suprématie juive ».
Pour autant, Israël refuse de libérer la Palestine occupée, de reconnaître les droits des Palestiniens dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Cela a été formellement écrit dans la Charte sioniste du Likoud, encore revue en 1997 : « Il n’y aura jamais d’Etat palestinien à l’ouest du Jourdain ». En même temps, Israël refuse de donner la citoyenneté israélienne aux Palestiniens sous occupation, car cela changerait les rapports démographiques, donc in fine la situation politique du pays !
Trump fait un nouveau cadeau à Netanyahou le 21 mars 2019, une nouvelle entorse au droit international : il reconnaissait l’annexion, en décembre 1981, du Golan syrien, conquis militairement par Israël en juin 1967. Trump a avancé l’argument de la sécurité d’Israël. Il a simplement oublié que la frontière internationale de la Syrie a été tracée en 1923, donc bien avant la création de l’Etat israélien ! Il ferme la mission palestinienne à Washington et le Consulat étasunien à Jérusalem-Est. Il réduit l’aide des Etats-Unis à l’Autorité palestinienne et à l’UNRWA – qui depuis 1949 apporte secours aux « réfugiés » palestiniens.
Le journal Le Monde écrit : « On peut redouter que le Président des Etats-Unis ne s’arrête pas en chemin. Que le plan de paix israélo-palestinien qu’il promet depuis son arrivée à la Maison Blanche s’inscrive dans cet alignement complet sur les positions israéliennes et débouche sur de nouvelles humiliations pour les Palestiniens ».
Le « deal du siècle » !
Cela n’a pas manqué. Le 28 janvier 2020, Donald Trump, avec à ses côtés le seul Premier ministre israélien aux anges, devant un public acquis d’avance, dévoile son plan de paix, officiellement appelé : « De la Paix à la Prospérité, une vision pour améliorer la vie des Palestiniens et des Israéliens ». Le « deal du siècle » ! Nous ne sommes plus aux « Accords d’Oslo » : aucun Palestinien n’a été invité à la cérémonie ; ce plan a été préparé sans les consulter et il est censé décider de leur sort ! En fait, il s’agit davantage d’un plan de guerre contre les Palestiniens. Un plan à visée électorale pour aider Netanyahou à remporter les élections du 2 mars, et préparer la réélection de Trump en novembre 2020 par ce cadeau fait à ses électeurs, les chrétiens sionistes évangéliques.
Le plan entérine l’annexion de toutes les colonies et de la vallée du Jourdain. Il prévoit bien un Etat palestinien – un archipel d’une demi-douzaine de cantons, séparés par des zones de territoires israéliens et reliés entre eux par des routes, des tunnels ou des ponts, avec une seule « frontière » directe avec un autre Etat, l’Egypte, à Gaza, mais là encore, sous contrôle israélien – dans ce qu’il reste de la Cisjordanie et Gaza (moins de 12 % de la Palestine mandataire), et bien évidemment, cet Etat est privé du moindre attribut de souveraineté.
Il ne fut pas question, bien sûr, de rétablir Jérusalem-Est comme capitale de cet Etat ; aucune souveraineté n’est reconnue aux Palestiniens sur les lieux saints musulmans ou chrétiens de la vieille ville, mieux « les fidèles de toutes les religions doivent pouvoir prier sur le Mont du Temple/Haram al Sharif ». Ce qui met fin au consensus concernant ce lieu depuis 1967 (pouvant entraîner des conséquences politiques très graves dans l’avenir). La capitale palestinienne pourra se trouver « dans la partie de Jérusalem-Est située dans les zones à l’est et au nord de l’actuelle barrière de sécurité » à Abu Diss et, comble de l’humiliation « pourra être nommée al-Qods ou un autre nom choisi par l’Etat de Palestine ».
Il ne fut pas non plusquestion du retour des « réfugiés » (expulsés) ou de leurs descendants : un rejet donc de la Résolution 194 de l’Assemblée général de l’ONU, sinon une infime minorité autorisée à s’installer dans les enclaves palestiniennes. Possibilité de transférer administrativement (les limites pas la population) des 300 à 400 000 Palestiniens du Triangle.
Le plan Trump se veut la base d’un accord définitif entre les protagonistes. C’est pour cette raison, à la différence des « Accords d’Oslo », qu’il entend régler l’ensemble de ces problèmes, mais seulement au bout de quatre ans, à la condition que les Palestiniens acceptent les termes fixés par le plan, notamment la reconnaissance d’Israël, comme Etat juif ; la démilitarisation de la Bande de Gaza ; la maîtrise de l’espace aérien réservé aux Israéliens ; l’interdiction par l’Autorité palestinienne de verser de l’argent « aux terroristes détenus en Israël », ainsi qu’aux familles « des terroristes morts » ; l’interdiction de toute démarche devant les instances internationales, comme la Cour pénale internationale… En bref, le plan muselle les Palestiniens et institutionnalise à tout jamais l’apartheid dans la Palestine occupée.
En observant la carte jointe au plan, on retrouve grosso modo le plan Allon, rédigé en 1967, à l’issue de la Guerre des six jours, par le vice-premier ministre travailliste Ygal Alllon : le plus de territoire et le moins de Palestiniens possible sous juridiction israélienne, après le constat que les Palestiniens n’abandonneraient plus le pays, comme en 1947/48, où ils avaient été expulsés. Cette carte 6essemble clairement aux Bantoustans d’Afrique du Sud – enclaves non alignées, de personnes sous domination, confinées derrière des murs dans leur propre patrie…
La déclaration du 28 janvier, devant une assemblée réjouie a été humiliante pour les Palestiniens. Pour être encore plus humiliant, Trump a offert en échange au peuple palestinien un don de 50 milliards de dollars ! Lui, le milliardaire, pense ainsi acheter ce peuple, qui résiste à l’occupation israélienne depuis des décades !
Pour B. Netanyahou, qui a lui-même détaillé le contenu du plan, de son plan, le 28 janvier, celui-ci marque un « tournant historique ». « Il efface à jamais les dangereuses lignes de 1967 ». Son plan est bien validé par les Etats-Unis, qui l’ont néanmoins mis en pause jusqu’aux élections israéliennes du 2 mars. Cela veut-il dire sine die ? Pour l’instant, ce plan n’est plus évoqué par les deux parties.
Quoi qu’il en soit, si des effets à court terme sont espérés, en particulier pour les réélections de Netanyahou et de Trump, le « plan de paix » constitue bien une entreprise de mise à bas de tous les paramètres respectés par les administrations étasuniennes précédentes, républicaines comme démocrates. Trump, le Président de la plus grande puissance du monde, n’hésite pas ainsi à montrer que, pour lui, le droit international n’a aucune valeur, que seuls comptent les rapports de force, les faits accomplis ; voire que l’ONU et son Assemblée générale ne sont d’aucune utilité quant à la recherche d’une solution de paix au Proche et Moyen-Orient, peut-être même d’une manière générale pour la paix dans le monde.
Le Général De Gaulle prévoyait lui-même ce risque dans sa fameuse prise de position du 22 novembre 1967 : « A moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l’évacuation des territoires et la reconnaissance réciproque de chacun des Etats en cause par tous les autres ».
Les condamnations et les silences
Le plan est condamné le soir même par le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, entouré des représentants des partis palestiniens, Fatah, Hamas, et Jihad islamique. Il menace un éventuel retrait de l’accord intérimaire d’Oslo, mais il ne le fera pas. Il ne peut le faire : l’Autorité palestinienne scierait la branche sur laquelle elle est assise. La Cisjordanie, comme Gaza, deviendrait une « prison à ciel ouvert » – si ce n’est déjà le cas de facto – avec toutes les conséquences dramatiques pour le peuple palestinien. Cela dit, tous les Palestiniens sont, bien sûr, unis contre. Pour Ziad Medoukh, professeur de français à l’université Al Qods de Gaza : « Ce plan, loin de chercher à ouvrir un chemin vers la paix, est un plan qui enterre la paix. Il est synonyme de scandale du siècle, voir l’arnaque du siècle qui vise à liquider la cause palestinienne, celle de tout un peuple sous occupation et sous blocus, peuple courageux et digne qui a choisi de résister et de rester attaché à sa terre de Palestine ».
De Mgr. Sabbah, l’ancien patriarche de Jérusalem, du Conseil œcuménique des Eglises, des Patriarches et des Chefs des Eglises de Terre sainte, au Mouvement Kairos Palestine, tous affirment l’iniquité profonde du plan proposé, et rappellent que la Paix, qu’ils sollicitent, est la fin de l’occupation et la reconnaissance, en toute justice, des droits du peuple palestinien.
Les réactions internationales n’ont pas tardé. Si la Jordanie, le Liban et la Syrie condamnent le plan, il n’a pas soulevé d’indignation générale chez les leaders arabes du Moyen-Orient, qui l’ont salué. Trois ambassadeurs arabes étaient même présents à la présentation du plan : ceux des Emirats arabes unis, de Bahrein et d’Oman ! La Ligue arabe et la Ligue islamique l’ont rejeté finalement, ce à quoi ne s’attendait pas Trump ; pas plus qu’il ne s’attendait à la déclaration du roi Salmane Ben Abdelaziz qui a fait savoir à son allié étasunien « qu’il rejetterait tout processus de paix qui ne reconnaîtrait pas Jérusalem-Est comme capitale du futur Etat palestinien et n’aborderait pas la question des réfugiés palestiniens ».
Les Etats occidentaux le saluent et le contestent plus ou moins – en laissant entendre qu’il est contraire au droit international et aux Résolutions des Nations Unies -, mais sans pour autant le condamner. C’est l’anesthésie la plus totale. Les Résolutions 181, 194, 242 et 338, la Déclaration européenne de Venise de 1980, et tant d’autres sont passées à la trappe. Certes, la France a maintenu les paramètres habituels, mais le gouvernement se cache derrière la nécessité d’une action commune des Etats européens – qu’il sait impossible en l’état – pour ne rien faire de concret pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Elle est ainsi complice de la poursuite de l’occupation de la Palestine. Le Saint-Siège (le Vatican), la Suède en dernier lieu, et 136 autres Etats ont eu plus de courage en reconnaissant l’Etat de Palestine, depuis sa proclamation en 1988.
Il faut tout de même noter, dès le 28 janvier, la déclaration du Haut représentant de l’Union Europénne, Joseph Borrel, qui souligne l’engagement constant de l’U.E. en faveur d’une solution à deux Etats, fondée sur les frontières de 1967, conformément aux principes internationaux. Mais, des mots, toujours des mots. Egalement, le 12 février, la diffusion par le Bureau des droits de l’Homme de l’ONU, de la liste des entreprises actives en Palestine occupée, dont les activités sont illégales au regard du droit international et des Résolutions de l’ONU.
Aussi, la réaffirmation du Conseil de Sécurité, le 25 février 2020, dans un rare moment d’unité, de « leur soutien à une solution négociée en faveur de deux Etats démocratiques, Israël et la Palestine » s’appuyant « sur les Résolutions pertinentes et précédentes de l’ONU, en accord avec le droit international ». Fait étonnant les Etats-Unis ont signé ce texte ! Ils font donc peu cas de leur propre plan, il est vrai le plan de Netanyahou.
Et aussi, la réaction d’une cinquantaine d’anciens ministres des Affaires étrangères ou ambassadeurs européens, comme Willy Classe (Belge), Massimo d’Allema (Italie), Dominique de Villepin (France), Ruth Dreifuss (Suisse), Mary Robinson (Irlande), Hubert Védrine (France) et bien d’autres :
« En tant qu’Européens soucieux de défendre le droit international, la paix et la sécurité dans le monde, nous exprimons notre profonde inquiétude face au plan du président Trump pour le Moyen-Orient (…). Ce plan entre en contradiction avec les principes convenus au niveau international concernant le processus de paix au Moyen-Orient, les Résolutions des Nations Unies, notamment la Résolution 2334 du Conseil de Sécurité et les principes les plus fondamentaux du droit international. (…) « De la paix à la prospérité » n’est pas une feuille de route pour une solution viable à deux Etats, ni pour une solution légitime du conflit ».
Celle du journaliste Bruno Frappat dans sa chronique de La Croix du 31 janvier : « Si l’on veut entretenir à l’infini la guerre des mémoires entre le peuple juif et les Arabes, on ne saurait mieux s’y prendre qu’avec ce « plan » provocateur, imaginé par la famille Trump et acclamé par l’extrême droite israélienne qu’incarne aujourd’hui Netanyahou ».
Il y a lieu aussi de relever que des Israéliens eux-mêmes contestent le plan étasunien. J’en prendrai pour exemple une lettre reçue du Directeur exécutif de B’Tselem, Hagaï El-Ad, écrite le 29 janvier 2020 : « Ce que les Palestiniens se voient offrir en ce moment ce n’est pas des droits ou un Etat, mais un Etat permanent d’apartheid. Aucun marketing ne peut effacer cette honte ou brouiller les faits. Mais les faits douloureux d’aujourd’hui font naître l’espoir de l’avenir, le seul qui puisse véritablement offrir la paix. Un avenir non fondé sur la suprématie pour certains et l’oppression pour d’autres, mais sur la pleine égalité, la liberté, la dignité et les droits pour tous. Ce jour viendra ». Des analystes israéliens sont tout de même inquiets : « le plan de paix de Trump peut nous mener à la guerre ».
3°/ Que faire ? comme disait Lénine.
Les chances de voir un jour le « deal du siècle » réalisé sont inexistantes. Mais qu’il le soit ou pas, toute idée de négociation entre Israéliens et Palestiniens, en permanence rappelée par exemple par le gouvernement français, est désormais exclue. Il n’y a d’ailleurs pas eu de vraies négociations politiques entre eux depuis 2007, et encore.
Il est donc urgent pour les Occidentaux non seulement de continuer à prôner la solution à deux Etats, mais à agir en reconnaissant sans plus tarder l’Etat de Palestine. Dans l’U.E., dont notre pays, les sociétés civiles, les associations, les personnalités laïcs ou religieuses, soucieuses de la paix au Proche-Orient, doivent par des manifestations, des articles, des lettres, montrer leur solidarité avec la résistance des Palestiniens et faire pression sur les gouvernements – comme, en France, le CRIF n’hésite pas à le faire en sens inverse.
Il y a une action importante à mener : s’associer à la campagne « Boycott, Désinvestissement, Sanction », suite à l’appel lancé, le 9 juillet 2005, aux sociétés civiles internationales et aux gens de conscience du monde entier, par 172 organisations et syndicats, représentant la société palestinienne. BDS a essentiellement pour but de faire respecter par l’Etat d’Israël le droit international qu’il ignore depuis sa création, plus que jamais aidé par les Etats-Unis de Trump, qui, je l’ai déjà dit, ignorent tout autant ce droit. Cette campagne s’appuie sur une longue tradition de résistance populaire dans le monde entier, du boycott des bus à Montgoméry en Alabama jusqu’à la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Cette campagne est si importante que le 11 juillet 2011, la Knesset a voté une loi permettant de poursuivre au civil toute personne ou organisation qui appellerait au boycott économique, culturel ou académique d’Israël. Et, en décembre 2017, le gouvernement israélien a approuvé un plan anti-BDS de 72 millions de dollars – qui représente le plus grand investissement jamais adopté par le pays – financé par lui-même et des dons juifs récoltés dans le monde entier. Dans ce cadre, Israël a décidé d’empêcher les militants des droits de l’homme, les critiques d’Israël (les soi-disant antisémites!) et les partisans de la campagne BDS d’entrer en Israël et dans la Palestine occupée.
Quoi qu’il en soit, historiquement, les boycotts finissent toujours par l’emporter.
Les Palestiniens, qui résistent étonnamment depuis près d’un siècle, savent qu’ils sont de plus en plus aidés par les opinions publiques internationales, malgré l’hypocrisie des dirigeants des Etats arabes, étasuniens ou européens. Cette solidarité qui chaque jour s’accroit dans le monde, y compris aux Etats-Unis, était loin d’être vrai en 1967.
Comme l’a dit un jour le cinéaste Eyal Sivan : « La société israélienne se sentira dans l’obligation de changer de paradigme à partir du moment où les moyens par lesquels elle se maintient dans sa supériorité ne seront plus en place. (…) Lorsque le monde leur renverra d’une manière suffisamment forte au visage l’horreur de l’entreprise sioniste, ils se résigneront peu à peu à renoncer à leurs privilèges, comme les Blancs de l’Afrique du Sud, l’ont fait ».
4°/ Un constat : la fin du projet sioniste
La solution à deux Etats, où tous les ressortissants auraient les mêmes droits, mettrait le sionisme au rancart. Le rejet massif par les Palestiniens du « deal du siècle », le développement de l’occupation et de la colonisation, conduisant inéluctablement à l’annexion, après celle de Jérusalem, de toute la Palestine – sauf peut-être de Gaza – laissent poindre la solution à un Etat. (Ce que réclament d’ailleurs aujourd’hui nombre de Palestiniens, en particulier parmi la jeunesse). Les Palestiniens seraient maintenus dans une condition de citoyens de seconde zone. Mais pour combien de temps ? A plus ou moins long terme, on assisterait à un retour au plan britannique de 1939, à l’Etat binational. Le Président de l’Etat d’Israël, qui soutient le Grand Eretz Israël, est lui-même partisan d’un Etat unique, mais où tous les citoyens, juifs et arabes, bénéficieraient des mêmes droits, des mêmes libertés… Il est l’un des rares juifs israéliens, avec quelques associations, proposant pareil Etat, La population palestinienne, hors les « réfugiés », est égale en nombre aujourd’hui à la population israélienne. Demain, elle la dépassera. Qui sera maître du pays, que certains rêveurs palestiniens appellent déjà « Israestine » ?
Feu Uri Avnery, critiquant dans son site, déjà cité, le 28 mai 2018, l’orgueil démesuré et l’appétit du pouvoir de Netanyahou et de ses thuriféraires, écrivait : « Ils mènent le pays à un Etat d’apartheid. Il n’y a aucune autre possibilité. L’Etat-Nation juif de la mer Méditerranée au désert, avec une majorité arabe, qui augmentera inexorablement jusqu’à ce que l’équilibre du pouvoir au sein de l’Etat bascule, que la situation internationale change, et que la volonté du « peuple élu » faiblisse. C’est arrivé dans l’Histoire à maintes reprises et cela nous arrivera. L’Etat juif se transformera en un Etat binational, avec une minorité juive, qui se réduira du fait que les Juifs ne voudront pas vivre dans un tel pays ».
Quoi qu’il en soit, jamais à travers l’Histoire une occupation a été éternelle. Elle n’a eu qu’un temps, sauf à éliminer les populations indigènes, comme l’ont fait les Etasuniens, ou les Australiens, lors de la construction de leur Etat, ou comme a tenté de le faire le mouvement colonial de peuplement sioniste, en expulsant 90 % de la population palestinienne en 1948/49. Mais aujourd’hui les Palestiniens d’Israël représentent plus de 21 % de la population d’Israël. Et les deux Etats ont chacun environ 5 millions d’habitants.
Aux dernières élections du 2 mars, la « Liste unifiée » a eu 13 élus. Plus de 20 000 juifs ont voté pour elle. Mais son caractère arabe est pour la très grande majorité des Israéliens juifs moins préoccupant que son caractère non-sioniste. La « Liste » a pour programme l’égalité des droits en Israël et la réalisation de deux Etats à pleine souveraineté.
Le sionisme depuis 1917, pour ne pas dire 1897, s’est transformé peu à peu en un système politique, minant les valeurs démocratiques et privilégiant une définition très étroite du sionisme, celle d’une idéologie nationaliste – même si ses thuriféraires vantent en permanence la « démocratie » israélienne. Pour les Juifs, oui. Mais pas pour les non Juifs.
En fait, de David Ben Gourion, fondateur de l’Etat d’Israël sans frontières – y compris lorsque la guerre pris fin au début 1969 par des accords d’armistice – à Netanyahou, partisan de l’annexion de toute la Palestine du mandat, les dirigeants israéliens, n’ont jamais eu l’idée de partager la terre de Palestine avec les Palestiniens.
Ils ont « oublié » qu’il existe un peuple arabe palestinien, musulman et chrétien, aussi attaché que les juifs à sa terre ; que cette question de la terre, celle de Jérusalem et du retour des « réfugiés » est centrale pour lui. Ainsi, du fait de son existence même, ce peuple empêche à tout jamais la réalisation du projet sioniste. Celui-ci est clair. Yosef Weitz, chef du Service de colonisation de l’Agence juive, déclarait dès 1940 : « Nous n’atteindrons pas notre but s’il y des Arabes dans ce petit pays. Il n’y a pas d’autre issue que de transférer les Palestiniens d’ici dans les pays avoisinants, de les transférer tous ». Comme le déclarait au quotidien Haaretz, Ariel Sharon, Premier ministre en 2001 – fondateur du Likoud en 1973 – « La guerre d’indépendance d’Israël n’est pas terminée » !
Le journaliste Gidéon Lévy écrit lui dans Haaretz, du 5 mars 2020 : « Le sionisme n’est pas sûr de lui. Il sait qu’il a provoqué une catastrophe pour un autre peuple et il sait que le feu du mal et de l’injustice brûle sous le tapis qu’il foule (…). Une véritable gauche ne naîtra ici que lorsque nous nous serons sevrés de l’addiction au sionisme et que nous serons libérés de ses chaînes ».
Yitzahk Epstein, le porte-parole de ceux qui refusaient l’égoïsme national écrivait dès 1913 : « Méfions-nous de cette cendre qui recouvre des braises ardentes ; une flamme s’en échapperait et ce serait un incendie que rien ne pourra plus éteindre ».
La critique la plus forte de l’idéologie sioniste actuelle me parait être celle, prémonitoire, d’Avraham Burg, ancien président de la Knesset, membre alors du Parti travailliste, dans Le Monde du 11 septembre 2003 : « La révolution sioniste reposait sur deux piliers : la soif de justice et une équipe dirigeante soumise à la morale civique. L’une et l’autre ont disparu. La nation israélienne n’est plus aujourd’hui qu’un amas informe de corruption, d’oppression et d’injustice. La fin de l’aventure sioniste est à notre porte ».
Alors, un Etat ou deux Etats ? Nous sommes bien à la veille du « commencement de la fin du sionisme ».
Avec la loi fondamentale du 19 juillet 2018, le national-sionisme est devenu officiellement le fondement de la politique d’Israël. Il est appuyé de plus en plus par un extrémisme religieux fondé sur des « théories apocalyptiques ». Ce national-sionisme disparaîtra, comme avant lui, le fascisme, le national- socialisme, ou le communisme ; voire la colonisation française (l’Algérie est devenue indépendante après 130 années de colonisation) ou britannique, en Afrique et en Asie. Tout est une question de rapport de force. L’immunité des dirigeants israéliens ne sera pas éternelle.
Je conclurai en soulignant la prise de position, le 16 mars 2020, d’Angela Davis, la dirigeante du Mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis : « Il est stimulant de voir qu’en cette sinistre période, où le fascisme et les partis politiques d’extrême droite progressent dans beaucoup de pays, de nombreuses personnes en prennent conscience (…) Et pour ceux et celles, qui partout luttent contre le racisme et la liberté, le peuple palestinien demeure une inspiration parce qu’il a souffert en restant inébranlable depuis si longtemps, refusant d’abandonner et d’accepter un assujettissement et une injustice permanente ».
Me Maurice Buttin, président d’honneur du Comité de Vigilance pour une Paix réelle au Proche-Orient (CVPR PO)