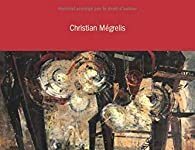Olivier Hanne est islamologue, docteur en Histoire, chercheur à l’Université d’Aix Marseille et professeur agrégé aux Ecoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. Médiéviste et spécialiste des crises du proche et du moyen Orient, il a notamment publié, parmi de très nombreux articles et ouvrages, Mahomet. Le lecteur divin, Paris, Belin, 2013 ; (dir.), Mali une paix à gagner. Analyses et témoignages sur l’opération Serval, Panazol, Lavauzelle, 2014 ; Guerres à l’horizon, Panazol, Lavauzelle, 2014 ; L’Etat islamique, anatomie du Califat, Paris, Bernard Giovanangeli, 2014 (prix du livre géopolitique décerné par la revue Conflits et EDF) Jihâd au Sahel. Menaces, opération Barkhane, coopération régionale, Paris, Bernard Giovanangeli, 2015 ; Géoculture. Plaidoyer pour des civilisations durables, Panazol, Lavauzelle, 2015 ; (coll.) Géopolitique de l’Iran, Paris, PUF, 2015 ; Islam et radicalisation dans le monde du travail (Paris, Bernard Giovanangeli, 2016) et La Grande Syrie : Des premiers empires aux révoltes arabes, (Paris, Bernard Giovanangeli, 2016).
Pour Géostratégiques, il bien voulu accepter de revenir sur la magistrale somme (539 p., 149 cartes et schémas dont un cahier central couleur) qu’il vient de publier en 2017, Les seuils du Moyen-Orient, histoire des frontières et des territoires aux éditions du Rocher.
Géostratégiques : Pourquoi le choix de l’expression Moyen-Orient dans le titre de votre ouvrage, alors que nous, Français, sommes plutôt habitués à la notion de Proche-Orient ? (peut-être même pourrait-on développer les précisions quant aux délimitations du Maghreb, Machrek, etc.)
Olivier Hanne : Parce que la notion de Moyen-Orient est plus englobante, elle s’étend à la Turquie, à l’Iran, à la péninsule arabique, et donc offre des moyens d’analyse plus complets et plus complexes. Bien qu’elle soit un pur produit de l’approche anglo-saxonne de cette région, elle me permettait d’aborder la question ethnique (Arabes / Perses / Turcs / Kurdes), la question des divisions en islam (chiites / sunnites) et dans le chiisme (duodécimains / septimains / zaydites…), alors que le Proche-Orient (schématiquement la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie) a une unité culturelle plus forte.
Géostratégiques : Et pourquoi les seuils plutôt que les frontières ?
Olivier Hanne : La frontière ici est un seuil : l’entrée de la maison, le point de passage d’un État à un autre, un niveau d’intensité minimal face à un stimulus. Or, le Moyen-Orient est constitué de frontières-seuils, c’est-à-dire de failles historiques et administratives qui ont été surinvesties par les psychologies et les mémoires collectives, et que celles-ci ne cessent de ruminer même après leur disparition. Sykes-Picot est un seuil, tout comme les limites de guerre de l’État islamique. La frontière est seuil parce qu’elle définit le sol de la communauté, et donc celle-ci ; elle est seuil en tant que passage entre le semblable et l’étranger, quand bien même l’étranger est un cousin. Derrière l’idée de seuil respire la culture…
Géostratégiques : Pourquoi avoir choisi l’histoire du temps long dans l’approche de la problématique de votre ouvrage ?
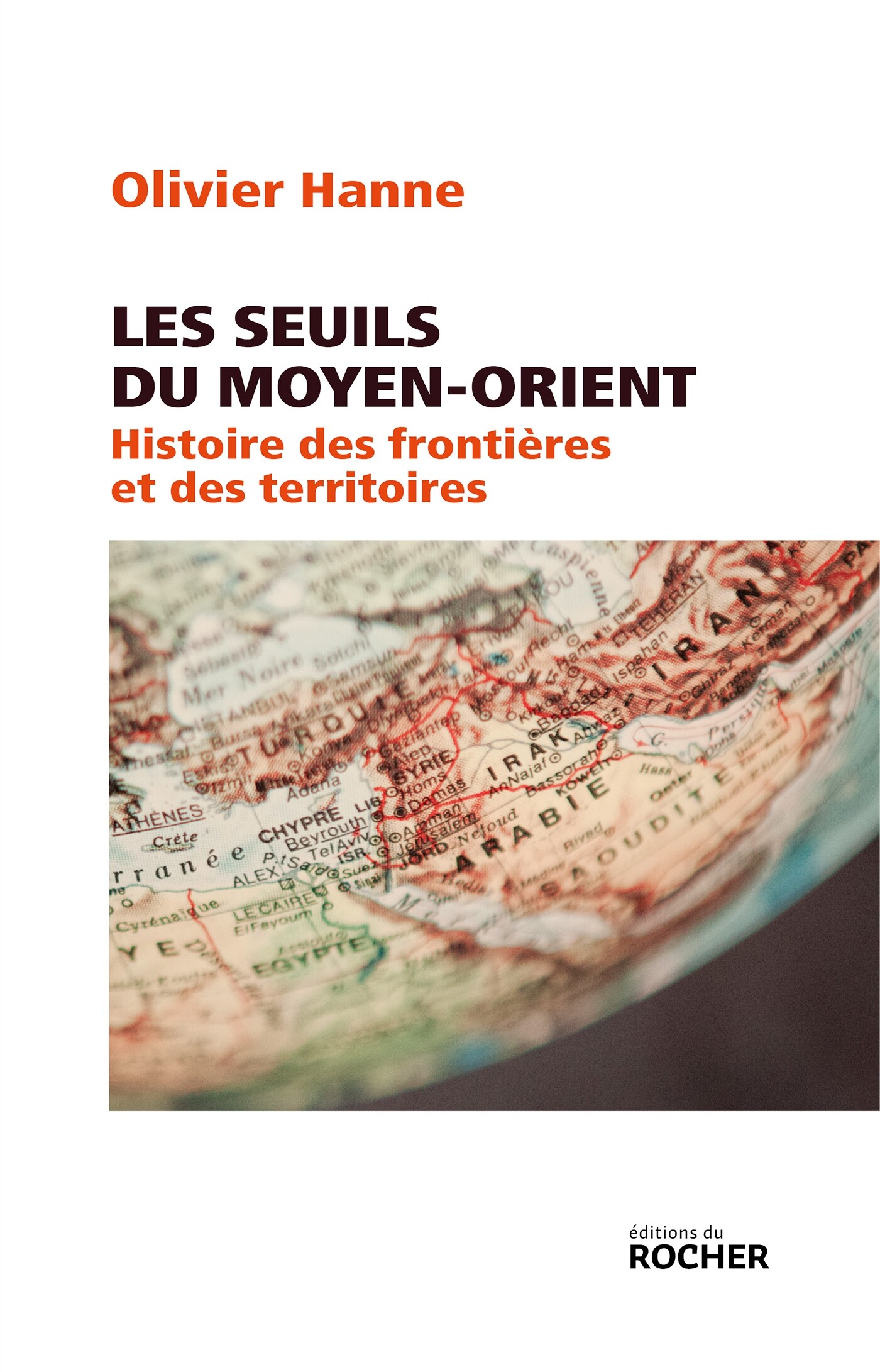
Olivier Hanne : Parce que l’ensemble de la production intellectuelle autour des crises actuelles dans la région se limite à remonter au début du XXe siècle et aux fameux accords de Sykes-Picot, comme si tout venait de là. Or, les territoires et les identités ont toujours été remis en cause par des acteurs extérieurs. C’est une constante depuis la préhistoire et qui ne doit rien à Sykes-Picot… Car le Moyen-Orient est un seuil de civilisations et de continents, un espace de parcours et de transit pour les peuples sémitiques du sud, pour les migrations asiatiques (indo-européens, Turcs, Mongols), et une terre de convoitise pour les empires européens (hellénistique, romain, coloniaux). Cette intrusion est consubstantielle à la région et a forgé ses identités, la résilience de ses populations et son instabilité. Ne pas regarder cette longue histoire revient immanquablement à accuser l’Europe et l’Occident d’être à l’origine de tous les maux de la région, et même de Daech…
Géostratégiques : Quel rôle la géographie de la région, steppes syro-irakiennes, socle arméno-kurde, etc., a-t-elle joué dans la définition de ses marches, seuils, confins et frontières ?
Olivier Hanne : Le cadre géographique du Moyen-Orient a profondément influencé la nature de l’occupation humaine, et donc les constructions politiques et leurs frontières. Là où la densité humaine était permise par le relief et / ou la végétation des systèmes étatiques ont vu très tôt le jour (vallée du Nil, Euphrate, etc.), soucieux de protéger leurs sujets et leurs revenus fiscaux, d’où la mise en place précoce de frontières délimitées et de marges disputées (Mésopotamie). En revanche, autour des espaces désertiques, des hauts reliefs (Arménie, Monts Taurus, Monts Zagros) et des plateaux répulsifs (Anatolie), la limite des contrôles politiques fut longtemps approximative et mouvante. L’aridité et la profondeur des déserts arabiques expliquent pourquoi les enjeux géostratégiques se concentrèrent jusqu’au XIXe siècle entre l’Asie Mineure et les monts Zagros, et ignorèrent le sud de la péninsule. Mais aucun empire, aucun État n’a pu fonder son territoire sur les seules données de l’environnement. Ni Rhin ni Pyrénées n’ont ici déterminé de limites intangibles. Tout au plus peut-on souligner combien a été importante la rupture entre les reliefs septentrionaux et les grands espaces arides du sud. Le Taurus a longtemps été une limite forte entre Byzance et l’islam, mais ce verrou a fini par sauter, et l’Asie Mineure, pourtant peu aisée à défendre, résista près de cinq siècles aux armées turques. L’idée de frontière naturelle réelle ou idéale paraît un artifice au Moyen-Orient, tant les milieux s’interpénètrent.
Géostratégiques : Vous soulignez, au début de votre ouvrage, la pluralité des systèmes de représentation collective du Moyen-Orient lesquels s’entrecroisent selon leurs différentes origines ; est-ce parce qu’il n’existe au fond aucune unité intrinsèque de cette région ?
Olivier Hanne : En effet, il n’y a jamais d’unité politique pérenne, et la composition ethnico-culturelle de cet Orient particulier ne cesse d’évoluer (disparition des Elamites, migration des Sémites, arrivée des indo-européens, ou encore des Turcs au Xe siècle, puis des Mongols au XIVe…). Forcément, on ne cesse de changer les dénominations pour désigner cet espace mouvant.
Géostratégiques : Vous évoquez une bipolarité géopolitique entre l’Est et l’Ouest sur un millénaire, un dualisme impérial, Rome puis Byzance d’une part, les parthes puis les Sassanides de l’autre, d’abord dans un cadre politique, religieux ensuite avec le culte impérial puis le christianisme pour les premiers et le zoroastrisme pour l’empire perse ; Y a-t-il une fatalité de la séparation entre Occident et Orient ou le rêve des Achéménides puis d’Alexandre aurait-il pu se réaliser sous une forme ou sous une autre ?
Olivier Hanne : La fatalité Ouest-Est se double aussi d’une fracture Nord-Sud régulièrement renouvelée (Egypte contre Hittites, sémites contre indo-européens, Arabes contre Byzantins puis Turcs…). Aucune unification n’a été durable, car les forces centrifuges se maintiennent, quelle que soit la politique du conquérant, violente ou accommodante.
Alexandre le Grand tente de construire un système original, culturellement grec, politiquement macédonien, mais multiethnique, appuyé sur l’idéologie monarchique achéménide. Il conçoit une unification des élites par les « noces de Suse » en 327 av. J.-C. Il fonde des colonies militaires qui enracinent les vétérans parmi les populations indigènes, mais fort peu lui survivront, sauf Alexandrie en Égypte.
Mais la révolte couve. En Perse et en Médie, des princes se rebellent. Des satrapes macédoniens sont accusés de pillages et de viols par la noblesse mède. Alexandre ne pourra pas construire d’État stable. Son empire est une réussite militaire qui a subjugué ses contemporains, mais sans leur proposer de modèle politique viable. Les ethnies composant l’empire se sont soumises, mais leur fidélité repose sur la haine partagée des Perses. Comme les Achéménides avant lui, l’exemple d’Alexandre prouve que la fin des frontières ne garantit pas la paix, et qu’un système universaliste peut être aussi violent que le fractionnement politique.
Géostratégiques : Les nombreux empires qu’a connu cette région ont-ils globalement pu imprimer des marques frontalières, pas seulement politiques, qui sont restées longtemps perceptibles après leur disparition ou la complexité régionale l’a-t-elle emporté avec le temps ?
Olivier Hanne : Le Moyen-Orient associe à chaque époque tous les types de frontières. Le système le plus courant jusqu’au XXe siècle fut l’espace de confins, indistinct, séparant sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur le monde urbanisé et sédentaire des espaces nomades, arides et menaçants. Cette rupture ne s’est atténuée qu’avec les années 1960-1970, sans disparaître totalement des mentalités, surtout dans la péninsule arabique. On relève aussi la zone-frontière entre deux empires ou deux cités, dont la dimension militaire est forte, et qui génère des sociétés de marge, dont on trouve un exemple contemporain dans les zones transit ou les camps pour réfugiés, ainsi à la frontière syro-turque ou syro-jordanienne. Ces deux types, qui offrent une variété infinie de nuances, sont prédominants dans la région, et resurgissent périodiquement, surtout pendant les phases de conflit. Les no man’s land militaires se sont déplacés au fur-et-à-mesure des siècles sans disparaître. La guerre en Syrie après 2012 a créé des territoires mouvants, séparés par des zones d’affrontement en évolution permanente, à la fois à cause des combats et des changements d’allégeance des différents belligérants. Enfin, certaines cités ont été des seuils autour desquels se sont construits des territoires, en raison de leur position convoitée, de leur rôle comme base de conquête ou de leur position au carrefour des axes et des migrations. Durant l’Antiquité, Doura-Europos et Antioche jouèrent ce rôle, au Moyen Âge Constantinople et Damas, à l’époque moderne Erzurum et Tabrîz.
Géostratégiques : Grande puissance méditerranéenne et asiatique, le territoire qui a délimité la conquête de l’Islam fut cependant marqué par la faiblesse de son origine nomade et son incapacité à exercer une autorité politique suffisante à l’ensemble de l’espace califal, fiction religieuse ; peut-on tirer une leçon de son inévitable morcellement en émirats pour les théoriciens de l’Islam politique d’aujourd’hui ?
Olivier Hanne : Le « domaine de l’islam » au Moyen-Orient obéit théoriquement à un seul pouvoir : le califat. Mais l’harmonie politique autour du calife est effectivement une fiction religieuse. Car le califat fut toujours concurrencé par des dynasties locales ou des pouvoirs hostiles, la plupart d’inspiration chiite, sans compter au VIIIe siècle les émeutes dans les villes. Bagdad vivait dans une insécurité sociale permanente. Les courants islamistes actuels ont donc un regard différencié sur le califat médiéval : si Daech l’a fait renaître, Al-Qaeda a toujours gardé ses distances avec cette référence prestigieuse mais synonyme de morcellement et même d’impiété (nombreux sont les califes peu zélés dans le domaine religieux, prenant parfois des ministres juifs ou chrétiens). Quant aux Frères musulmans, ils en appellent à une révolution populaire, où le pouvoir serait attribué à un président élu.
Géostratégiques : La Fitna et les nombreuses divisions au sein des courants principaux de l’Islam, ont-elles renforcé la difficulté ontologique de l’Umma à se comprendre dans le cadre d’une frontière (et par conséquent à éloigner toute possibilité réelle d’unification musulmane) ?
Olivier Hanne : Le califat islamique est bien plus qu’une fonction politique, car il induit avec le territoire un rapport de paix et de sécurité, qui renvoie à l’harmonie du cosmos. Les ‘Abbâsides, puisant dans l’idéologie sassanide, font du califat un pouvoir régulateur dont les vertus sont la sagesse et la justice. « Ombre de Dieu sur terre », le calife joue le même rôle que la clôture du jardin : il protège de la steppe aride et de la violence extérieure l’espace domestique cultivé, ombragé et irrigué. Le califat est donc une frontière. Mais le monde est, quant à lui, binaire, et l’islam médiéval a fait naître une approche religieuse de l’espace, structuré autour de deux « demeures ». Dans le dar al-islâm (« demeure de l’islam »), le monde est en paix, protégé, obéit aux lois de Dieu et à ce que le Coran pose comme licite. Or, justement, ces lois sont appelées hudûd, « frontières ». L’unicité divine (tawhîd) est proclamée et nul ne songe à adhérer à l’infidélité. La Umma y est rayonnante. Au-delà des frontières se situe le dar al-harb (« demeure de la guerre »), un monde barbare et chaotique (la jahiliya), hostile à l’islam, où les fidèles sont persécutés, isolés, où règnent le taghût, la « transgression », et le péché sous toutes ses formes (harâm). Ici, les musulmans sont vivement appelés à rejoindre la Umma en faisant leur émigration (la hijra), comme Muhammad avant eux. Tous les fidèles doivent leur venir en aide par le jihâd. Entre les deux espaces, la frontière est mouvante, car il faut bien commercer et échanger avec l’ennemi, d’autant plus depuis les années 1960 et l’immigration massive en Europe.
Géostratégiques : Les rivalités entre grandes villes au sein du Califat et plus tard au sein de l’empire ottoman (Damas, Bagdad, Le Caire, etc.) est-elle une permanence des systèmes politiques musulmans essentiellement urbains ?
Olivier Hanne : L’islam a favorisé le monde urbain. Si la conquête a pu détruire certaines cités anciennes, elle en a aussi renouvelées et créées d’autres ex nihilo. Les territoires du Moyen-Orient islamique sont polarisés par les centres urbains, et notamment par la capitale, Damas puis Bagdad, qui font figure de métropoles énormes, cosmopolites, pluriethniques et pluriconfessionnelles. La violence sociale qui y règne est toutefois difficile à gérer pour les pouvoirs califaux. Ici, aucune féodalité ; le château rural n’est pas un centre économique et politique, mais uniquement un site militaire. Les campagnes sont entièrement sous contrôle des élites urbaines, particulièrement lorsque celles-ci sont turques. Mais, dans la réalité, les espaces politiques ne cessent de changer selon l’équilibre des forces en présence. Certaines dynasties bédouines maintiennent en outre leurs coutumes nomades et leur gouvernement se veut itinérant. Rien n’est stable ni sûr.
Géostratégiques : Les conflits entre les Ottomans et les Safavides, contribuèrent-ils à fixer historiquement la ligne de séparation entre l’Iran et le monde arabe notamment sur la ligne de front que fut l’Irak (et dans le cadre plus large de l’opposition monde sémitique et Perse safavide) ?
Olivier Hanne : L’Irak fut la principale épine territoriale entre Ottomans et Safavides et une zone de guerre permanente. Terre arabe, mais où le chiisme devenait majoritaire, elle bascula dans l’empire ottoman, malgré ses liens anciens avec la Perse. Celle-ci la considérait comme une partie du domaine iranien. En mai 1639, la Sublime Porte et la Perse signèrent le traité de Zuhâb pour fixer leurs frontières, document qui constitua la base de tous les règlements suivants, jusqu’au XXe siècle. La Perse obtenait l’Arménie orientale et l’Azerbaïjan, mais renonçait à la Mésopotamie, aux marécages du Khûzistân, et acceptait d’être bornée par les monts Zagros. Mais les Ottomans ne parvinrent pas à unifier la région, qui resta excentrée, sous-développée et fragmentée, ce que l’on observe encore aujourd’hui (Irak kurde, Irak sunnite, Irak chiite).
Géostratégiques : Pourriez-vous évoquer la nouvelle irruption contemporaine de l’Occident dans le problème ottoman à travers la « question d’Orient » ?
Olivier Hanne : La modernisation du Moyen-Orient va commencer dans les régions les plus à l’Ouest : l’Égypte, la Turquie et le Levant. Cette ouverture rapide sur l’Europe et l’industrialisation contribuera à affaiblir l’empire ottoman, et à susciter une compétition entre les puissances pour mettre la main sur son économie et ses territoires, rivalité que l’on qualifie à l’époque de « Question d’Orient ». L’ingérence européenne est constante au XIXe siècle. Mais si les Russes veulent hâter le démembrement de l’empire pour accéder aux Détroits et libérer les chrétiens des Balkans et de Terre sainte, les Britanniques et les Français souhaitent maintenir en l’état cet « homme malade » avec lequel ils peuvent traiter et où ils s’investissent financièrement.
Géostratégiques : La création de la Turquie et l’homogénéisation des territoires sont-elles les seules causes et conséquences du premier génocide du XXe siècle ?
Olivier Hanne : Le génocide est le résultat volontaire de la politique des différents gouvernements turcs visant à turquifier l’Anatolie depuis les années 1890, et involontaire, à cause du cours de la guerre : en enrôlant dès 1914 des miliciens arméniens, la Russie a fait de la minorité chrétienne une cinquième colonne aux yeux des Turcs. Malgré son caractère exceptionnel (1,2 million de morts), ce massacre n’est que la suite logique de la politique d’homogénéisation ethnico-religieuse des territoires turcs, dont l’objectif était la fondation, dans le sang, d’un État-nation uniforme, totalement inadéquat au Moyen-Orient. En 1914, 4 millions d’Arméniens vivaient à cheval sur la Russie, la Perse et la Turquie, dont 2 millions dans ce dernier pays, partout minoritaires, sauf dans les provinces de Van et Erevan. Le congrès de Berlin (1878) s’inquiéta de leur situation d’opprimés, mais les puissances européennes ne purent leur venir en aide. Par réaction, ils accueillirent favorablement le socialisme puis le marxisme, mais la fin de la Première guerre mondiale fit échouer leurs rêves d’indépendance.
Géostratégiques : Pour vous citer, « peut-on défendre la ligne Sykes-Picot » ?
Olivier Hanne : Les accords de Sykes-Picot ont provoqué, dès les années 1920, des critiques virulentes. Mais la carte imaginée en 1916 était moins aberrante qu’on a pu le dire. En effet, la frontière septentrionale obéissait au particularisme culturel arabe, vivement opposé à la domination turque. Vers l’est, les limites étaient celles de la Perse, déjà établies depuis le XVIIe siècle, malgré des changements ponctuels. Vers le Levant, la séparation programmée entre la Syrie et les terres chrétiennes du Liban, voire de Phénicie, correspondait aux attentes des minorités, qu’elles fussent maronites ou alaouites, peu pressées d’être intégrées à un État hachémite ou musulman. Les accords répondaient en partie aux attentes des alliés locaux de l’Europe.
Plus que sur les territoires eux-mêmes, l’accord était contestable sur son principe colonial et sur les idées politiques véhiculées. En important les définitions européennes de l’État, de la frontière et de la gestion publique des hommes, Sykes-Picot méprisait les complexes réalités de la région, lesquelles avaient toujours accepté plusieurs niveaux d’allégeance politique, et une appréhension de l’espace à géométrie variable. Les négociateurs – positivistes – crurent qu’en important le patriotisme exclusif et le cadre juridique européens, ils feraient oublier 4 000 ans d’Histoire. Là réside leur plus grande faute…
Géostratégiques : Quel est le rôle exact joué par les hydrocarbures dans la détermination des frontières ?
Olivier Hanne : Les premières concessions pétrolières de la région ont été découvertes en Iran en 1901 et attribuées à la Grande-Bretagne. Outre les compétitions entre les grandes puissances, le pétrole a poussé tous les acteurs à réclamer une extension ou une délimitation précise de leurs frontières, ce qui n’était pas forcément le cas avant.
Par exemple, au Yémen du Nord, le pétrole fut en partie à l’origine de la guerre civile (1962-1967). Les compagnies étrangères cherchaient à obtenir des autorisations de prospection dans cette zone peu exploitée par rapport au Golfe persique. Or, le souverain yéménite les avait limitées aux côtes et aux frontières, là où son pouvoir était contesté. Pour les compagnies, un changement de pouvoir ouvrirait de nouvelles possibilités de prospection vers l’intérieur des terres.
La fin de la guerre civile dans ce pays déclencha des hostilités régulières avec le Yémen du Sud. Après chaque phase d’affrontements, les chefs d’État réaffirmaient leur volonté d’unifier les deux pays, en vain. Toutefois, les discussions bilatérales, commencées en 1988, profitèrent de l’effondrement du bloc soviétique, et surtout de la découverte d’un gisement pétrolier à la frontière des deux Yémen, lequel ne pouvait être exploité sans coopération. La fusion des deux républiques put être finalisée en mai 1990.
Géostratégiques : L’influence de la guerre froide et de l’internationalisation des conflits intérieurs, a-t-elle été majeure dans les bouleversements du second XXe siècle ?
Olivier Hanne : L’internationalisation des conflits au Moyen-Orient ne date pas du XXe siècle, toutefois le phénomène s’est accentué après 1945 pour deux raisons. D’abord, parce que la région était un terrain d’affrontement des puissances mondiales, où les États-Unis avaient dès la Seconde Guerre mondiale une position dominante. Ils voulurent combler le « vide de puissance » dans la région, après le départ des Britanniques et des Français. Ensuite, parce que les pouvoirs locaux sollicitèrent cet interventionnisme extérieur afin d’obtenir la reconnaissance internationale des nouvelles frontières acquises ou conquises, ou une aide matérielle dans des conflits asymétriques. L’URSS, puis l’Iran, agirent ici pour renverser le contrôle établi par les États-Unis et leurs alliés. Le Liban et le Yémen, déjà affaiblis, firent les frais de ces antagonismes.
Durant la Guerre froide, les équilibres politiques et territoriaux étaient peu remis en cause, sauf autour d’Israël. L’arabisme était une forme locale du marxisme. Pour le bien du statu quo mondial, les conflits devaient demeurer localisés. Bien des États étaient faibles (Koweït, Jordanie), voire faillis (Liban), mais tous dépendaient d’un protecteur qui stabilisaient ses territoires, ainsi l’Arabie Saoudite pour le Qatar ou le Bahreïn. Mais la guerre du Golfe consacra au Moyen-Orient le « moment américain » (1991-2011). Washington préserva pendant dix ans les équilibres régionaux en maintenant Saddam Hussein et en refusant l’éclatement de l’Irak. Puis, les attentats du 11 Septembre 2001 modifièrent entièrement la stratégie américaine. Quittant le pragmatisme géopolitique, les États-Unis imaginèrent un vaste regime change. Il fallait contraindre Israël à faire la paix avec les Palestiniens, démocratiser l’Irak et l’Iran. Le Moyen-Orient était devenu un espace barbare à civiliser, quitte à employer la force.
Géostratégiques : Finalement, les frontières n’ont-elles été que des lieux de conflits (et les partages territoriaux n’ont-ils été que des éléments de déstabilisation ?) alors qu’on observe une relative stabilité des frontières depuis un siècle ?
Olivier Hanne : Le XXe siècle dévoile des frontières à tout prendre étonnement stables : plus de reconfiguration globale comme au XIIIe siècle ou en 1918, plus de redécoupage imposé de l’extérieur. Des corrections de tracés ont eu lieu, souvent dans la violence (Arabie Saoudite, Irak, Israël), et sous l’influence d’acteurs étrangers, mais la plupart ont concerné des zones réduites, ainsi entre les deux Yémen ou autour du Chatt al-‘Arab. Est-ce à dire que les frontières issues de la Première Guerre mondiale étaient plus pertinentes qu’on ne l’a dit ? Cela signifie surtout que les populations du Moyen-Orient sont malléables et résilientes. Elles sont malléables lorsqu’elles acceptent des bornages artificiels qui cassent leurs dynamiques historiques (exemples kurde et palestinien), mais auxquels elles finissent par s’identifier. Malgré les discours virulents des responsables politiques égyptiens ou syriens, il était évident qu’on ne pourrait plus revenir sur les découpages de 1919, ou alors à la marge, parce que d’autres découpages auraient été pires, parce qu’aucun système n’aurait pu satisfaire toutes les identités, et parce que des caractères nationaux s’étaient forgés peu à peu, ou du moins des traits communs construits par la vie quotidienne et les références partagées à l’histoire récente. Un patriotisme pouvait naître.
Mais ni le nationalisme ni l’autoritarisme n’ont pu accoucher de la nation. Les frontières étant un phénomène principalement politique, l’incapacité à les établir sans angoisse relève de l’échec politique. De fait, la Syrie et l’Irak montrent qu’en développant un État omniprésent, bureaucratique et intrusif, les pouvoirs espéraient unifier les communautés du pays, mais leur appropriation de l’État européen – dit westphalien – fut clientéliste, ethniciste et brutale.